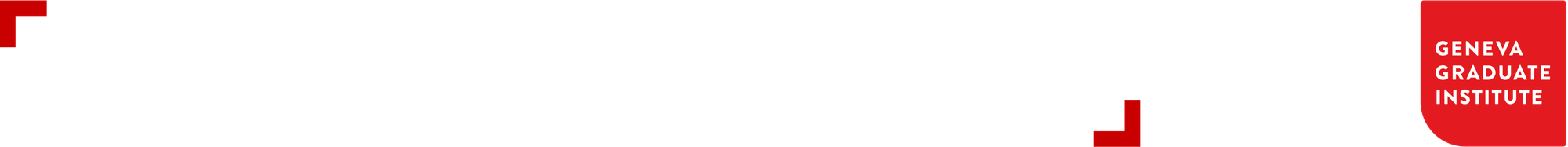Par Jérôme Duberry
Les technologies ont joué un rôle prépondérant tout au long de l'histoire des relations internationales, en particulier de par le lien étroit qui existe entre l’innovation technologique, la sécurité et la puissance. Leur nature à double-usage s’est illustrée tout au long des siècles : la technologie nucléaire, au même titre que les biotechnologies, les neurosciences et l’intelligence artificielle, ont des applications simultanément bienveillantes et malveillantes, et des impacts imprévisibles selon le contexte social, économique et environnemental.
La réalité est complexe et appelle à des réponses tout aussi complexes. Et pourtant, la technologie est souvent présentée comme une solution rapide et sûre, avec des résultats tangibles, qui plaisent aux conseils d'administration, aux donateur·trices et aux électeur·trices. Evgeny Morozov a rendu célèbre le terme de techno-solutionnisme dans son livre publié en 2013 intitulé To Save Everything, Click Here : The Folly of Technological Solutionism. Il y décrit notre propension à nous tourner vers la technologie comme solution facile aux défis du monde réel.
Toute technologie est politique. Elle est le résultat de choix et de décisions prises par un groupe d’individus, et reflète des valeurs et intérêts temporellement et géographiquement localisés. Sans refléter la diversité du monde réel dans le design des technologies, le techno-solutionnisme renforce les pratiques existantes de surveillance et de contrôle excessif des populations marginalisées, et donc accentue les inégalités. À ce titre, Philip Alston, rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, tire ainsi la sonnette d'alarme sur les risques associés à la numérisation des services de l’Etat, qui utilise les données et les technologies pour automatiser, prédire, surveiller, cibler et punir les plus pauvres.
Face au dérèglement climatique, le techno-solutionnisme nous propose une vision du monde où l’humain peut contrôler totalement son environnement. Si l'Anthropocène décrit l'émergence d'une nouvelle ère géologique qui se caractérise par l’avènement humain comme principale force de changement sur Terre, le techno-solutionnisme ne nous promet pas un désordre planétaire inédit, mais bien un contrôle surpassant les forces géophysiques, une forme d’hyper-anthropocène.
Le techno-solutionnisme - ainsi que le populisme et la politique réactionnaire - sont à la fois les causes et les tentatives malheureuses de répondre à l'incertitude radicale actuelle. l'incertitude radicale actuelle.
Ce faisant, cette idéologie s’aligne – volontairement et involontairement – sur la vision du monde des populismes de droite et autres politiques réactionnaires, qui figent le monde autour d’un modèle de société passé et de déni des défis actuels. L'impulsion réactionnaire n'est pas nouvelle, et fait surface chaque fois qu'il y a un changement brutal et soudain dans la société. Elle permet de s’illusionner avec des solutions rapides technologiques et des slogans politiques qui simplifient les enjeux en proposant un retour vers un passé hypothétique. Ils nient ainsi la complexité et les vérités les plus dérangeantes de notre époque contemporaine. Le techno-solutionnisme, tout comme le populisme et les politiques réactionnaires, est à la fois la cause et la tentative malheureuse de réponse à l'incertitude radicale actuelle.
Quelles alternatives s’offrent à nous ? Comment être à l’aise avec cette nouvelle complexité du monde ? Comment s’assurer que la technologie contribue aux innovations démocratiques, sociales, environnementales et pour le bénéfice de tous ?
C’est tout d’abord la réalisation que seul, aucun·e acteur·rice ne peut répondre aux défis actuels et à venir. C’est en développant des formes de collaboration innovantes, qui incluent la technologie, les sciences dures et sociales, les organisations intergouvernementales et les gouvernements, la société civile et les entreprises dans toute leurs diversités, que nous pourrons répondre à cette convergence de défis. De nouvelles formes de partenariat public-privé pour le développement durable apparaissent et démontrent leur pertinence pour combiner à la fois l'efficacité et d'autres qualités importantes telles que la responsabilité, la transparence et la démocratie.
La technologie seule ne peut rien faire. C'est par sa mise en œuvre par l'homme qu'elle peut contribuer au bien commun ou le détruire. Et c'est dans son contexte social et environnemental que nous pouvons comprendre les enjeux.
Il s’agit aussi de rester humble face à la complexité de l’expérience humaine et aux résultats attendus des innovations technologiques. Seule, une technologie ne peut rien. C'est seulement à travers sa mise en œuvre qu'elle peut contribuer aux biens communs ou les détruire. Et c’est dans son contexte social et environnemental qu’il est possible d’appréhender les enjeux. Les sciences sociales sont bien équipées pour envisager la technologie dans son contexte au regard de la diversité de l’expérience humaine.
Enfin, une approche de prospective participative et engagée permet de combiner à la fois les pratiques collaboratives innovantes, et les méthodologies pour envisager l’avenir et influencer le présent. Ce faisant, il est alors possible de ne plus laisser à certain·es acteur·rice·s hégémoniques le pouvoir de coloniser le futur, mais bien au contraire de l’ouvrir à tous, et en particulier à la jeunesse. Le futur est ici en chacun de nous : c'est une compétence individuelle et collective. L’agentivité individuelle et collective, la science, ainsi que le courage, sont essentiels pour guider ce développement technologique et inspirer des exercices d'anticipation.
Dans ce contexte, Genève, symbole de dialogue, de paix et de démocratie, a un rôle particulier à jouer. La ville de Calvin, Rousseau et Dunant combine en effet l'expertise en matière de pratiques collaboratives innovantes, d'anticipation et de gouvernance technologique, grâce à la présence d'acteur·rice·s dans les secteurs publics et privés engagés dans la gouvernance des défis mondiaux et de la technologie.
À propos de l’auteur
Dr. Jérôme Duberry est directeur général du Tech Hub, conseiller académique de l'Executive Programme in International Negotiation and Policy-Making, et chercheur au Albert Hirschman Centre on Democracy (AHCD) et au Centre for International Environmental Studies (CIES) du Geneva Graduate Institute.
Clause de non responsabilité
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les points de vue du Geneva Policy Outlook ou de ses organisations partenaires. Cet article est une traduction d'une version originale en anglais. Pour toute utilisation officielle de l'article, veuillez vous référer à la version anglaise.