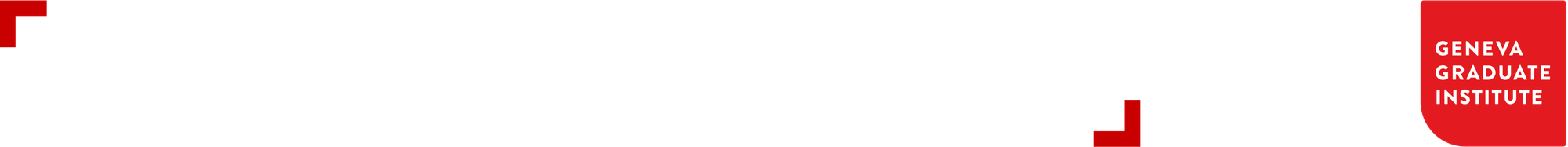Par Hugo Slim
La magnifique ville de Genève présente une curieuse contradiction. Entourée de merveilles de la nature, elle ne parle que des humains. Tournant le dos à la nature, les diplomates et fonctionnaires internationaux présents à Genève semblent ignorer le paysage somptueux qui les entoure pour se concentrer sur une seule espèce.
Cette indifférence envers la nature s’estompe le week-end et de nombreux résidents de la Genève internationale se dirigent alors avec entrain vers les montagnes, les lacs et les forêts. Mais au-delà d’être un simple objet de loisir, la nature devrait également être une dimension importante de leur multilatéralisme au quotidien. Genève est bien placée pour façonner une nouvelle approche de la politique mondiale, positive pour la nature, et elle devrait s’y mettre rapidement.
Mettre la planète au cœur de la politique internationale
La nature est un angle mort de la Genève diplomatique. Ceci doit cesser. L’urgence climatique l’exige, et des signaux positifs montrent que le changement est en cours.
L’Organisation météorologique mondiale (OMM) est désormais un acteur de premier plan du tournant planétaire de la politique mondiale, marquant un net changement dans sa capacité à communiquer sur les risques et les tendances météorologiques. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) se sont associés pour appeler à une action mondiale en faveur de la protection de la nature dans un contexte de crise climatique. Le projet Sphère, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) ont élaboré ensemble de nouvelles lignes directrices pour des solutions fondées sur la nature dans l’action humanitaire. L’IFRC met de plus en plus l’accent sur la protection de l’environnement au titre du droit international humanitaire (DIH).
La majorité du travail qui est fait à Genève porte sur le climat. Cependant, il serait préférable d’envisager un agenda planétaire pour protéger notre Terre et permettre à l’humanité et à la nature de s’adapter ensemble dans les années à venir. Bien que le changement climatique soit la cause de la situation difficile de notre siècle, ses effets sont plus justement perçus comme une urgence planétaire au sens large. On comprend mieux l’humanité si on l’appréhende comme une composante particulière d’une communauté terrestre plus large, et non en tant qu’espèce autonome.
Un discours politique uniquement structuré par le changement climatique nous maintient la tête dans les nuages. Une politique véritablement planétaire au contraire permettrait aux institutions de porter des stratégies visant à soutenir une humanité inscrite dans l’intégralité des formes de vie et à éviter les points de bascule qui risquent de rendre le monde invivable pour les humains et pour la biodiversité que nous aimons tant et dont nous avons besoin. Parmi ces points de bascule on trouve les changements dans la cryosphère et l'hydrosphère, comme la fonte des glaciers ou le réchauffement du lac Léman.
Reconnaître que l'humanité est inscrite dans la nature
Genève a été très active dans la défense de l’humanité au cours des 200 dernières années par l’intermédiaire de ses multiples normes, traités et institutions, reconnaissant notre espèce en tant que communauté morale unique dont les membres doivent prendre soin les uns des autres. Aujourd'hui, Genève doit aller plus loin.
Dans les années à venir, la Genève internationale se doit d’approfondir la doctrine de l'humanité, en reconnaissant l’identité et les intérêts qui nous lient à la communauté terrestre plus large des végétaux et des animaux, ainsi qu’à l’ensemble des écosystèmes terrestres.
Dans les années à venir, la Genève internationale se doit d’approfondir la doctrine de l'humanité, en reconnaissant l’identité et les intérêts qui nous lient à la communauté terrestre plus large des végétaux et des animaux, ainsi qu’à l’ensemble des écosystèmes terrestres. Reconnaître l’humanité comme faisant partie intégrante d’une communauté terrestre mènera à l’élaboration de politiques qui valorisent et protègent les intérêts mutuels des humains et de la nature, en sachant que nos vies et nos moyens de subsistance dépendent de cette dernière.
La vie humaine n’est rien sans les autres formes de vie. Les besoins de la nature et ceux des humains se recoupent souvent. Les décideurs internationaux doivent donner la priorité à des stratégies d’entraide où l’humanité aide la nature et la nature aide l’humanité. Dans les politiques des Institutions à Genève et au-delà, nous devons porter des stratégies de développement et des formes d’action humanitaire qui reconnaissent de manière explicite l’humanité comme étant inscrite dans la nature.
La représentation de la nature à Genève et au-delà
La nature doit siéger aux nombreuses réunions et négociations de Genève, et elle a un intérêt clair dans l’élaboration des politiques.
Une étape essentielle pour parvenir à cette harmonie avec la nature est de lui reconnaître un statut de sujet politique à part entière et de la représenter en conséquence dans la diplomatie genevoise. La nature doit siéger aux nombreuses réunions et négociations de Genève, et elle a un intérêt clair dans l’élaboration des politiques.
Mettre sur la table les besoins et le pouvoir d’action de la nature est une tâche urgente dans le cadre du multilatéralisme. Déléguer des représentants des forêts, des rivières, des animaux et des écosystèmes dans l’élaboration de politiques permettrait de doter la nature d’une personnalité propre. On peut également le faire en développant activement les Droits de la nature et les Droits de la Terre nourricière, ou encore le nouveau droit humain à un environnement propre, sain et durable dans le Conseil des droits de l'homme. Le DIH reconnaît déjà le statut de civil de l’environnement naturel.
Le nouveau Pacte pour l'avenir des Nations Unies est décevant à tous ces égards. Il ne propose aucune nouvelle vision de la nature dans la politique mondiale et échoue à donner une place centrale à la Terre et à sa protection en tant que condition sinequanon du succès de l’humanité. Cette omission grossière de New York doit permettre à Genève d’œuvrer à la rectifier en mettant urgemment la nature autour de la table.
L’OMS et la communauté sanitaire de Genève avancent déjà rapidement en donnant priorité aux politiques d’Une seule santé ou de « Santé planétaire » qui reconnaissent notre relation avec la nature comme un facteur déterminant pour la santé humaine et visent à réduire les risques sanitaires exacerbés par le changement climatique.
De la même manière, l’OMC et l’OIT ont un rôle à jouer. La politique en matière de commerce et de travail doit reconnaître de manière explicite les besoins et le rôle de la nature dans la construction d'une nouvelle économie verte. Une approche du commerce respectueuse de la nature est vitale au moment où les entreprises trouvent de nouvelles synergies avec la nature pour créer des énergies renouvelables, accélerer la révolution des matériaux, déployer des infrastructures adaptées et une agriculture résiliente.
Le HCR et l’OIM doivent s’associer avec le WWF, l’UICN et l’OMS pour aborder les questions du mouvement et d’immobilité des animaux, des végétaux, des insectes et des microbes au moment où le changement climatique perturbe les habitats et les force à migrer avec les humains.
La communauté genevoise du maintien de la paix, et notamment le Centre pour le dialogue humanitaire et Interpeace, doit reconnaître à la nature le statut de partie aux négociations et permettre aux humains de faire la paix avec elle. Un tel processus de paix implique de réduire la violence contre la nature et entre les humains en unissant ces derniers autour d’intérêts communs sur des sujets comme l’eau, le sol, les écosystèmes, le bétail, le refroidissement et la biodiversité. Pour cela, il est notamment possible de passer par une « Earth Diplomacy » confidentielle, qui permet d’éviter certaines complexités politiques.
Enfin, les organisations de défense des droits humains et de la nature devraient se rapprocher beaucoup plus. Les deux grandes organisations de défense de la nature, l’UICN et le WWF, devraient être accueillies pour leurs connaissances, leurs réseaux et leur expertise. Elles devraient être fréquemment invitées à Genève pour corriger la vision étroite associée à des mandats institutionnels trop souvent centrés uniquement sur l’humain.
Dans le multilatéralisme actuel, il faut que la nature quitte son statut d’observateur permanent de l’élaboration des politiques genevoises, depuis ses sommets et ses forêts, pour assumer la place qui lui revient en tant que membre permanent de la Genève internationale, avec sa mission et ses représentants.
À propos de l’auteur
Hugo Slim est chargé de recherche principal au Las Casas Institute for Social Justice at Blackfriars Hall de l’université d’Oxford et professeur invité à l’International Academy of Red Cross Red Crescent à l’université de Suzhou. Son nouvel ouvrage s’intitule Humanitarianism 2.0 - New Ethics for the Climate Emergency (« L’humanitarisme 2.0 : une nouvelle éthique pour l’urgence climatique »).
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les points de vue du Geneva Policy Outlook ou de ses organisations partenaires.