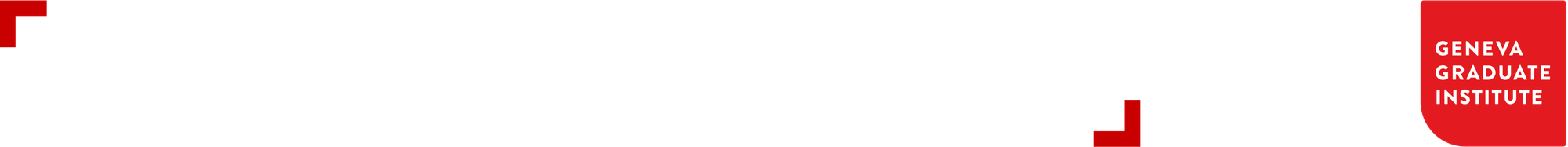Par Hiba Qasas
En septembre 2023, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Jake Sullivan a donné à voir le tableau d’un Moyen-Orient « apaisé ». Nombreux étaient ceux qui partageaient l’opinion selon laquelle le statu quo semblait durable, sans qu’il ne soit nécessaire de traiter du problème israélo-palestinien de manière très impérative. Les efforts de normalisation régionaux semblaient éluder complètement la question palestinienne, et l’attention internationale étant dirigée ailleurs, il n’y avait pas d’urgence à se réengager.
Cette fragile illusion a été brisée le 7 octobre. Le traumatisme a été d’une grande ampleur, et d’une grande profondeur. Les attaques ont entraîné plus de 1 200 décès chez les Israéliens, et plus de 100 otages demeurent en captivité. Un an plus tard, la guerre a coûté la vie à environ 45 000 Palestiniens, dont 13 000 enfants, déplaçant plus de 90 % de la population gazaouie et laissant Gaza en ruines. Il ne s’agit pas uniquement d'une escalade du conflit et d'une catastrophe humanitaire ; cela souligne les menaces existentielles et le traumatisme intergénérationnel ressentis à la fois par les Israéliens et les Palestiniens.
Le 7 octobre a révélé le besoin urgent de nouveaux piliers : la diplomatie et l’engagement politique. Sans ces aspects, aucun cadre de sécurité n’est complet.
Le 7 octobre a révélé l’illusion et la défaite des doctrines sécuritaires les plus extrêmes. Trois piliers du cadre de sécurité israélien ont échoué : la dissuasion, les renseignements et la victoire rapide et décisive. Cela a mis en avant le besoin urgent de nouveaux piliers : la diplomatie et l’engagement politique. Sans ces aspects, aucun cadre de sécurité n’est complet.
L’endiguement sans résolution n’est pas possible à long terme. La réalité de l’occupation et de l’insécurité ne peut plus être ignorée pour la voie de la stabilité régionale pérenne. Ce moment est un tournant stratégique non seulement pour Israël mais également pour toute la région, désormais confrontée à un paysage plus déstabilisé et explosif que jamais.
Trois transformations majeures : une nouvelle réalité
La crise actuelle nous force à regarder en face trois transformations importantes qui indiquent une nouvelle réalité pour la région :
- La prise de conscience d'un statu quo intenable : le statu quo n’apporte pas la sécurité aux Israéliens ou la dignité et l’autodétermination aux Palestiniens, ce qui force les deux sociétés à reconnaître que les moyens militaires ne sont pas la panacée. En dépit de l’importance croissante des voix radicales, la vision selon laquelle le progrès dans la région nécessite de prendre à bras le corps de manière directe le conflit israélo-palestinien convaint de plus en plus d’adeptes. Si le soutien d’une solution à deux États est généralement faible en Israël, s’établissant à 34 % seulement, il s'élève à plus de 60 % lorsqu’il est exprimé dans le cadre d'un programme de normalisation régional et d’un cadre politico-sécuritaire plus large. Parmi les Palestiniens, 70% soutiennent soit un modèle, soit une confédération, à deux États.
- Une transformation de la dynamique internationale : après avoir été négligé pendant des années, le conflit israélo-palestinien attire de nouveau l’attention internationale. Les mouvements « I stand with Israel » et « I stand with Palestine » amplifient la polarisation déjà en hausse, l’antisémitisme et l’islamophobie, des campus aux rues en passant par les campagnes électorales. Les acteurs internationaux ont désormais un impératif d’agir. Ils ont de l’influence et peuvent exercer la pression nécessaire pour jouer un rôle indispensable dans la résolution du conflit.
- Un déficit de leadership : le profond manque de confiance envers le leadership politique dans les deux sociétés permet à de nouveaux acteurs : dirigeants d’entreprise, experts en sécurité, faiseurs d’opinion, élite et société civile, et même alliés politiques improbables, d’entrer en jeu. La vieille garde étant incapable d’aller de l’avant, ou ne souhaitant pas le faire, cela ouvre la porte à un mouvement mené par le peuple défendant un nouveau paradigme.
Changer la donne : les nouveaux défenseurs de la paix
Les establishments israéliens et palestiniens reflètent la transformation de l’opinion publique en matière d’affaires et de sécurité. Traditionnellement distincts de l’activisme en faveur de la paix, ils font de plus en plus entendre leur voix à propos de la menace existentielle posée par le retour au statu quo. S’ils utilisent les termes de « séparation » ou de « divorce », leur objectif final est le même : une solution à deux États qui apporte la sécurité à Israël et l’auto-détermination aux Palestiniens. Cette approche pragmatique gagne du terrain sur l’ensemble du spectre politique. Ces acteurs reconnaissent qu’attendre les conditions parfaites pour la paix est le meilleur moyen de prolonger le conflit indéfiniment.
Les entreprises et établissements de sécurité israéliens et palestiniens font de plus en plus entendre leur voix à propos de la menace existentielle posée par le retour au statu quo.
Au milieu de la tragédie et des voix radicales, il y a encore de l’espoir. Un sondage récent montre que 74 % des Israéliens envisagent désormais la résolution de la question palestinienne comme cruciale pour leur sécurité. Toutefois, la défiance demeure profondément ancrée : 86 % des juifs israéliens et 94 % des Palestiniens ne considèrent pas l’autre camp comme digne de confiance. Des décennies de violence, de traumatisme et de récits opposés alimentent une déshumanisation généralisée, rendant difficile la conception de solutions communes.
À Principles for Peace et par l'intermédiaire de l'initiative Uniting for a Shared Future (USF), nous avons vu ce mouvement prendre forme, rassemblant des dirigeants issus du monde de l’entreprise, de la sécurité, des médias, de la politique et de la société civile. Notre coalition a adopté cinq principes directeurs : la reconnaissance mutuelle du droit des deux peuples à l’auto-détermination, à l’indépendance et à la condition étatique ; la sécurité et la sûreté ; la dignité ; le pouvoir d’action et l’inclusion ; et la confiance par l’intermédiaire de la guérison. Ces principes forment la base d'un nouveau cadre politique.
Malgré les propos affirmant « qu’il n’y a pas de partenaire dans l’autre camp », il y a bien des partenaires pour la paix dans chaque camp. La coalition de l’USF se tient prête à tirer parti de l’influence, de la crédibilité et de l’ingéniosité de ses membres pour nouer des partenariats solides avec les acteurs internationaux et régionaux. La priorité immédiate est de mettre fin à la violence continue dans ses multiples dimensions. La planification du relèvement post-conflit est essentielle pour nous assurer de jeter les bases d'une paix pérenne.
Davantage de guerre, ou la paix
Le chemin vers la paix est souvent plus court lorsqu’il est parcouru depuis les profondeurs de la douleur et de la perte plutôt que depuis le confort du statu quo. L’immédiateté de la crise actuelle exige des mesures urgentes. Au-delà des préoccupations humanitaires se trouve une opportunité stratégique rare. La question est de savoir si les dirigeants se saisiront de ce moment ou le laisseront leur échapper, condamnant une nouvelle génération au conflit.
Le vrai réalisme à l’heure actuelle signifie reconnaître que la paix, loin d’être un luxe idéaliste, est le seul chemin à suivre qui soit pragmatique. L’alternative est un cycle sans fin de violence qui ne sert les intérêts d’aucun camp.
Les personnes qui rejettent les initiatives de paix en les taxant de naïves doivent être mises face à une réalité gênante : l’approche actuelle n’a ni donné la sécurité aux Israéliens, ni l’auto-détermination aux Palestiniens. Le vrai réalisme à l’heure actuelle signifie reconnaître que la paix, loin d’être un luxe idéaliste, est le seul chemin à suivre qui soit pragmatique. L’alternative est un cycle sans fin de violence qui ne sert les intérêts d’aucun camp.
Être à la hauteur de l’opportunité
Cette opportunité ne se présentera peut-être plus de notre vivant. Si nous la gaspillons, le coût se mesurera en termes non seulement de vies perdues aujourd’hui, mais également d’avenir confisqué à des générations d’enfants israéliens et palestiniens.
En fin de compte, il n’y a que deux voies possibles : la poursuite des destructions des deux sociétés par la guerre, ou la paix. Les gagnants de ce jeu perdu d’avance seront ceux qui joueront un scénario différent : ceux qui commencent dès maintenant à construire la paix, reconnaissant que la véritable victoire réside dans le fait de mettre fin au conflit ensemble.
À propos de l’auteur
Hiba Qasas est la directrice exécutive fondatrice de la Fondation Principles for Peace à Genève et une artisane de la paix riche de plus de 22 ans d’expérience dans la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Elle a occupé des postes à responsabilité aux Nations Unies, et notamment représentante dans le pays en Irak et directrice de la Section du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à ONU-Femmes. Hiba a également co-organisé Uniting for a Shared Future, collaborant avec les dirigeants israéliens et palestiniens pour promouvoir la sécurité, la dignité et la condition étatique pour les deux peuples. Son expertise couvre les régions touchées par les crises, la résilience et l’autonomisation des femmes.
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les points de vue du Geneva Policy Outlook ou de ses organisations partenaires.