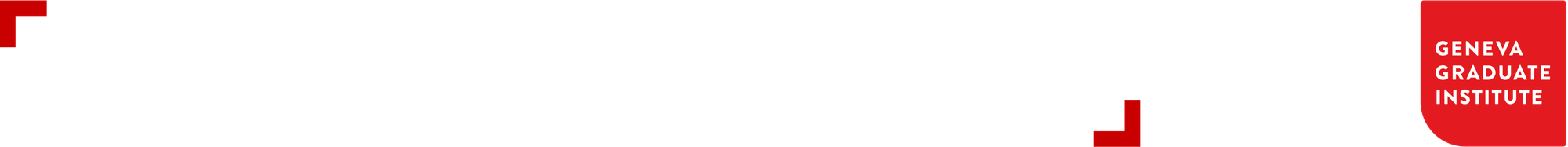Par Margo A. Bagley
Le Traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (le « traité GRATK », d’après son acronyme anglais), conclu au siège de l’OMPI à Genève (Suisse) en mai 2024, représente un triomphe du multilatéralisme. Avant l’adoption du traité, le multilatéralisme dans le domaine de la propriété intellectuelle (PI) paraissait extrêmement bancal. Le dernier traité relatif à la PI avait été conclu plus d'une décennie auparavant, et les efforts menés au sein du Conseil des ADPIC de l’OMC pour renoncer aux protections liées à la PI afin d’accélérer le déploiement des vaccins, des traitements et des équipements de protection contre la COVID au plus fort de la pandémie n’ont entraîné qu’un relâchement très modeste des contraintes relatives à l’octroi de licences obligatoires pour les vaccins.
Étant donné que la signature d’un nouveau traité multilatéral est une occurrence rare, cet article retrace les moments clés qui ont ouvert la voie à un accord. L’historique du processus de négociation met en avant les rôles phares joués par la préparation et l’opportunisme stratégique.
Le traité GRATK : quelques éléments contextuels
Le traité GRATK oblige les parties contractantes à exiger des demandeurs de brevets d'utilité qu'ils divulguent l'origine ou la source des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées pour les inventions revendiquées fondées sur ces ressources ou informations. Il prévoit également l'imposition de mesures appropriées en cas de violation de l'obligation de divulgation. Elle ne crée pas de nouveaux droits. Il s'agit plutôt d'une mesure de transparence qui peut contribuer à éviter l'octroi de brevets sur des objets non nouveaux. Elle peut également faciliter le respect des obligations de partage des avantages liés aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles prévues par la convention des Nations unies sur la diversité biologique et son protocole de Nagoya.
C’est le premier traité en matière de PI qui mentionne les peuples autochtones et les communautés locales, les principaux créateurs et détenteurs de savoirs traditionnels sur l’utilisation des ressources génétiques, qui assurent souvent l’intendance et l’amélioration de telles ressources. Ainsi, il insuffle un sens de l’équilibre dans un système de PI autrement plutôt asymétrique, connu pour promouvoir des protections qui bénéficient largement aux créateurs, titulaires et utilisateurs des pays à revenu élevé, souvent au détriment des pays du Sud.
Le succès de la négociation du traité GRATK a eu un coût : 25 ans de négociations, les pays du Sud exigeant un progrès et de nombreux pays à revenu élevé dépendants de l’industrie opposant leur résistance et se satisfaisant du statu quo.
Mais ce résultat a eu un coût : 25 ans de négociations, les pays du Sud exigeant un progrès et de nombreux pays à revenu élevé dépendants de l’industrie opposant leur résistance et se satisfaisant du statu quo. À mon avis, cette situation serait probablement encore constatée aujourd’hui si deux événements critiques n’avaient pas eu lieu : l’un impliquant la préparation et l’autre l’opportunisme stratégique.
La voie vers l’accord
En 2012, après 13 ans de discussions sinueuses au sein du Comité intergouvernemental, le texte de synthèse sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (le texte de synthèse) a été publié. Il résumait ces années de discussion et servait de base aux négociations qui auraient lieu par la suite. Cependant, parce que chaque État membre avait le droit de voir sa position reflétée dans le document, il a été progressivement envahi de centaines de crochets (indiquant le désaccord), de multiples variantes à de nombreux articles et de certaines dispositions purement et simplement conflictuelles (telles que l’article sur l’absence d’« obligation de divulgation »). Malgré cela, des progrès ont eu lieu , si bien qu’en 2018, l’adoption d'une révision du texte (reflétant d'importants compromis) a été bloquée par un État membre, laissant apparemment les négociations au point mort.
Cependant, cet échec a permis à un phœnix de renaître des cendres des négociations : le Texte du président. Le président du Comité intergouvernemental d’alors, Ian Goss (Australie), avait rencontré de manière stratégique de nombreuses délégations afin d’identifier les domaines d’accord potentiel ; il bénéficiait également du travail réalisé en coulisses par un groupe divers de pays représentant plusieurs régions géographiques. Cela lui a permis de mettre au point et de proposer en 2019 un Texte du président soigneusement rédigé, suffisamment spécifique et délicatement équilibré qui avait l’apparence d'un vrai traité mais qui ne pourrait pas être encombré de dispositions opposées, comme le texte de synthèse avait pu l’être.
En 2022, l’invasion injustifiée de l’Ukraine par la Russie, un événement en apparence non lié au Comité intergouvernemental, a catapulté le Texte du président dans une conférence diplomatique d’élaboration de traité.
Les choses en sont pour l’essentiel restées là pour le Texte du président et le document de synthèse après cela, en raison de la pandémie et de la sélection d’un nouveau président du Comité. Mais en 2022, l’invasion injustifiée de l’Ukraine par la Russie, un événement en apparence non lié au Comité intergouvernemental, a catapulté le Texte du président dans une conférence diplomatique d’élaboration de traité.
Comment cela s'est-il produit ?
Saisir l’opportunité dans un contexte politique en évolution
L’OMPI fonctionne généralement par consensus. Le vote est rare et mal vu. Cependant, au début de la 55e session des Assemblées générales de l’OMPI en juillet 2022, l’intégration au programme d'une disposition visant à apporter une assistance technique en matière de PI à l’Ukraine en raison de l’agression russe a mené à des remises en question de la part de la Russie. Cela a mené à (horreur des horreurs) un vote ! En réalité, plusieurs votes se sont tenus sur cette question au cours des Assemblées générales.
Si chaque groupe acceptait de soutenir la proposition combinée (et faisait pression sur les États partageant le même état d’esprit pour qu’ils fassent de même) et que la question en venait à être soumise à un vote, il devrait y avoir suffisamment de votes pour adopter la mesure : l’opportunisme stratégique à son sommet.
Mais là où certains ont perçu une opposition, d’autres ont perçu une opportunité. Si les membres de l’OMPI étaient ouverts au vote sur un sujet, pourquoi pas sur un autre ? Et pourquoi pas une conférence diplomatique, ou deux ? Des diplomates de pays demandeurs dans le Comité intergouvernemental ont rencontré des diplomates de pays à revenu élevé qui souhaitaient l’adoption du projet de Traité sur le droit des dessins et modèles, qui attendait depuis des années dans un autre comité de l’OMPI, et ont proposé des tractations : l’accord pour organiser deux conférences diplomatiques afin de donner naissance à deux nouveaux traités. Si chaque groupe acceptait de soutenir la proposition combinée (et faisait pression sur les États partageant le même état d’esprit pour qu’ils fassent de même) et que la question en venait à être soumise à un vote, il devrait y avoir suffisamment de votes pour adopter la mesure : l’opportunisme stratégique à son sommet.
Vers l’accord
En fin de compte, le vote ne s’est pas avéré nécessaire. La minorité de pays opposée à un traité GRATK a choisi de mettre fin à la vague de votes à l’OMPI en s’abstenant de bloquer un accord de consensus portant sur l’organisation de deux conférences diplomatiques en 2024. Toutefois, sans un Texte du président bien préparé et semblable à un traité suffisamment prêt pour une conférence diplomatique, même la menace d'un vote n’aurait pas permis d’atteindre ce résultat.
Bien entendu, d’autres facteurs ont contribué à l’adoption du traité GRATK, y compris le talent et le pouvoir de persuasion du président de la conférence diplomatique, Guilherme Patriota (Brésil), le travail en coulisses de la Division des savoirs traditionnels de l’OMPI, et les efforts d’un grand nombre de négociateurs sur de nombreuses années. Toutefois, les deux événements cités illustrent bien, à mes yeux, la raison pour laquelle il a été possible de conclure ce traité dans un monde où le succès d'un accord multilatéral est loin d’être acquis.
Le traité représente-t-il un triomphe du multilatéralisme ? Assurément, mais c'est un triomphe qui a été atteint par l'intermédiaire d'une série de conflits et d’échecs de négociations, avec des acteurs à l’esprit stratégique arrachant la victoire des mâchoires de la défaite et capitalisant sur des événements en apparence sans lien. Si une telle convergence ne sera peut-être pas facile à reproduire, cela a cependant constitué un accomplissement remarquable.
À propos de l’auteur
Margo A. Bagley est professeure de droit « Asa Griggs Candler » à l’école de Droit de l’université d’Emory. Elle a été Amie du président du Comité intergouvernemental de l’OMPI de 2018 à 2023, et a occupé le poste de Rapporteur au Comité intergouvernemental de 2014 à 2018.
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les points de vue du Geneva Policy Outlook ou de ses organisations partenaires.