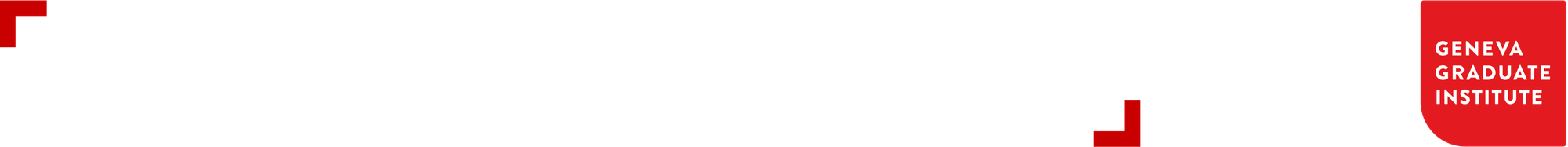Par Solomon Dersso
Il est désormais largement reconnu que le système multilatéral traverse une crise grave. D’un côté, le bref moment unipolaire d’après-guerre froide qui a donné corps à une coopération multilatérale pendant plus de trois décennies a pris fin. Nous sommes en train de vivre la transition vers un « nouvel ordre mondial » caractérisé par la multipolarité, pour reprendre les termes du Secrétaire général des Nations unies António Guterres. Décrivant une particularité fondamentale de ce moment, son Nouvel Agenda pour la paix indique que « la dynamique du pouvoir est devenue de plus en plus fragmentée compte tenu de l’émergence de nouveaux pôles d’influence, de la formation de nouveaux blocs économiques et de la redéfinition des axes de contestation. » Il note également « que la confiance entre les pays du Nord et du Sud s’érode ».
D'un autre côté, le monde est confronté à ce que certains décrivent comme des polycrises : des crises multiples et croisées telles que l’urgence climatique, les pandémies ou la pauvreté et l’inégalité, qui nécessitent l’action collective de l’ensemble des régions.
En raison de ces transformations et de ces difficultés, la gouvernance mondiale se trouve désormais à un carrefour majeur. De nouveau, pour reprendre les mots de M. Guterres, le système multilatéral est confronté à un choix difficile : « la réforme ou la rupture ». Selon le Rapport du groupe de haut niveau d'experts sur l'Afrique et la réforme du système multilatéral (Report of the High-level Panel of Experts on Africa and the Reform of the Multilateral System), la réforme est le seul choix possible pour la majorité de la planète.
Une perspective africaine sur la gouvernance mondiale actuelle
Dans son mode de fonctionnement, la gouvernance mondiale n’a pas été véritablement mondiale, mais centrée sur les pays du Nord.
Un aspect essentiel de l’agenda des réformes est lié à la réinvention de l’organisation et du fonctionnement de la gouvernance mondiale. Jusqu’à maintenant, dans son mode de fonctionnement, la gouvernance mondiale n’a pas été véritablement mondiale, mais centrée sur les pays du Nord. Si nous prenons en compte le lieu où s’exerce la gouvernance mondiale, on observe que de nombreuses de ses institutions se situent dans les pays du Nord, principalement en Europe et aux États-Unis. Genève, en sa qualité de pôle des droits humains des Nations Unies, mais aussi en tant que lieu de domiciliation de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres agences des Nations Unies telles que l’Organisation mondiale de la Santé, elle constitue l’un de ces centres de la gouvernance mondiale.
L'un des principaux domaines de réforme consiste à faire en sorte que les institutions de la gouvernance mondiale soient représentatives, afin de remédier aux lacunes de la conception actuelle de la gouvernance mondiale. On cherchera ainsi à s'assurer que les populations non représentées et sous-représentées aient une voix dans la prise de décisions au sein d’institutions telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies.
L’autre domaine de réformes concerne le mode de fonctionnement du système multilatéral, comme le reflètent les débats sur le vaccin contre la COVID-19 et la réaction internationale aux atrocités commises dans le cadre de différents conflits. Tirant parti de leurs effectifs à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a acquis une importance renouvelée dans les débats politiques mondiaux, les pays du Sud ont partagé leur vision de progresser vers plus d’inclusivité lorsque l'Afrique a mené la planète pour adopter la décision de l’Assemblée générale des Nations Unies d'élaborer une convention des Nations Unies sur la coopération fiscale.
Au-delà de la convention fiscale, les États Membres africains des Nations Unies, qui constituent 28 % du nombre total des États Membres de l’institution, aux côtés d’autres pays du Sud dans le cadre du G77 + la Chine, ont su tirer profit de leur nombre au cours de la négociation sur le Pacte pour l’avenir. Outre les concessions qu’ils ont obtenues concernant la réforme des institutions financières mondiales, les États africains ont joué un rôle de premier ordre dans la mise en échec de la manœuvre russe visant à faire dérailler le consensus sur le Pacte pour l’avenir à la fin du processus de négociation. Portant la voix de tous les États Membres africains des Nations Unies, la motion du Congo ayant conduit au rejet de la proposition d’amendement de la Russie, l’a emporté et a assuré l’adoption du Pacte par la manière convenue - via le consensus.
Les pays africains qui tirent parti de leur force numérique peuvent s’exprimer dans d’autres pôles politiques et diplomatiques. Genève en est un bon exemple.
Au-delà des réformes mises en avant ci-dessus, la poursuite de la proposition de Guterres d'un multilatéralisme en réseau « dans lequel la famille des Nations Unies, les institutions financières internationales, les organisations régionales, les blocs commerciaux et d’autres collaborent plus étroitement et plus efficacement » présente un intérêt particulier comme moyen de rendre la gouvernance mondiale efficace et véritablement mondiale.
Le rôle de l’Union africaine à l’ère du multilatéralisme en réseau
Selon M. Guterres, le renforcement et l’intégration systématique du rôle des organisations régionales, et plus particulièrement de l’Union africaine (UA), est un aspect fondamental du multilatéralisme en réseau. Comme il l’énonce dans Notre Programme commun, les organismes régionaux « jouent un rôle central dans le maintien de la paix ainsi que dans la prévention des conflits et la lutte contre l’insécurité » et « sont un pan important de notre architecture mondiale de paix et de sécurité ».
C’est également une reconnaissance que la mise à profit du rôle des organisations régionales est utile pour rendre la gouvernance mondiale véritablement mondiale et moins centrée sur le Nord. Les organisations régionales, particulièrement celles du Sud, doivent être impliquées de manière systématique plutôt que sur une base ad hoc.
L’UA est un exemple éminent d'un organisme de type régional. Elle est basée à Addis-Abeba (Éthiopie), qui s'enorgueillit d'être l’un des principaux pôles diplomatiques du monde. Outre l’UA, Addis accueille également 134 ambassades ainsi que la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies.
Au cours des deux dernières décennies, et de plus en plus ces dernières années, l'UA est devenue une plateforme majeure pour façonner et influencer la gouvernance mondiale.
Au cours des deux dernières décennies, et de plus en plus ces dernières années, l'UA est devenue une plateforme majeure pour façonner et influencer la gouvernance mondiale. Cela se reflète dans la manière dont elle a mobilisé la voix collective de ses États membres pour faire progresser les biens publics mondiaux. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’UA est devenue un exemple de multilatéralisme efficaceà l'œuvre à un moment où les pays, particulièrement dans le Nord, adoptaient une attitude de repli sur eux-mêmes. Le rôle de l’UA pour faire progresser la paix et la sécurité internationale est largement reconnu. La récente ascension de l’UA, illustrée par son adhésion au G20, reflète davantage son rôle croissant dans les sphères liées à l’économie et au développement de la gouvernance mondiale.
La création de passerelles entre Addis-Abeba et Genève
On reconnait désormais que la gouvernance mondiale ne peut pas rester figée, autant géographiquement qu'au sens figuré, centrée sur le Nord. Le multilatéralisme en réseau qui implique de tirer parti du rôle de l’UA en mobilisant ses membres pour constituer un bloc de vote majeur aux Nations Unies, par le biais d'un échange politique et d’une coordination étroits entre Addis-Abeba et Genève, est prometteur pour rendre la gouvernance mondiale véritablement mondiale, l’adaptant ainsi aux transformations et aux difficultés de ce nouvel ordre multipolaire émergent.
L'un des axes de développement de ce multilatéralisme en réseau consiste à instaurer et à maintenir des relations de travail étroites entre les centres de gouvernance mondiale, tels que Genève et Addis-Abeba. Cet objectif peut être atteint, entre d’autre, en promouvant le dialogue politique entre les deux pôles diplomatiques sur différentes questions politiques d'importance mondiale. Parmi les domaines potentiels de coopération plus étroite, on peut citer les suivants :
- Étant donné le rôle de l’UA dans la paix et la sécurité, l’efficacité de l’action collective sur la paix et la sécurité peut être renforcée via une coordination plus étroite entre Addis-Abeba et Genève. Cela pourrait au moins mener à la minimisation de l’opposition du Groupe africain aux initiatives du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies visant à traiter de la dimension des droits de l'Homme dans les conflits.
- S’appuyant sur le flux de travail des conflits et des droits humains, en 2025, le thème de l'année de l'UA est « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine grâce aux réparations ». En tant que tel, il offre une autre occasion de favoriser la collaboration entre les deux pôles. M. Guterres et Volker Türk ont été enregistrés, et soulignent la nécessité de faire de la justice réparatrice une priorité pour rémédier aux séquelles de l’esclavage et du colonialisme, qui continue à avoir un impact négatif sur la vie quotidienne des personnes affectées.
- Troisièmement, l’effort actuel de l’UA pour rendre opérationnelle la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), à laquelle l’OMC, basée à Genève, s’intéresse de très près, représente un autre aspect d’une telle coordination politique étroite entre les deux pôles. Cela favorisera également l’action en réponse à la question : quel rôle la ZLECAf peut-elle jouer pour faire progresser le Programme de développement durable à l'horizon 2030 ?
2025 pourrait ainsi devenir l’année pour mettre au test différentes pistes d’échange entre Addis Abeba et Genève dans l’objectif de construire un multilatéralisme en réseau encore plus robuste pour l’avenir.
2025 pourrait ainsi devenir l’année pour mettre au test différentes pistes d’échange entre Addis Abeba et Genève dans l’objectif de construire un multilatéralisme en réseau encore plus robuste pour l’avenir.
À propos de l’auteur
Solomon Dersso est directeur fondateur d’Amani Africa, un think tank de recherche en politique, de formation et de conseil panafricain indépendant.
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les points de vue du Geneva Policy Outlook ou de ses organisations partenaires.