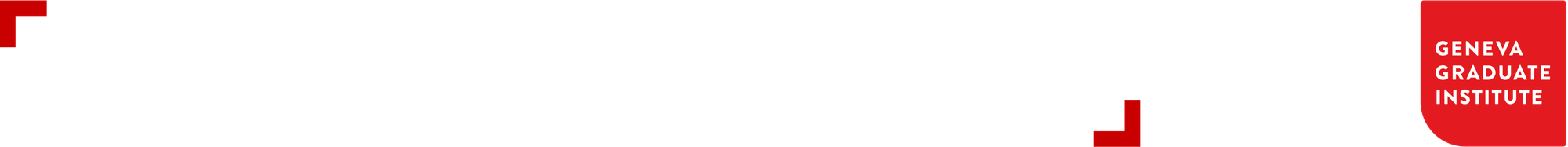Par Jussi Hanhimäki
A à en croire la sagesse populaire, le multilatéralisme serait mort après l’élection de Donald Trump. Huit décennies de coopération internationale seraient sur le point de prendre fin. Une ère d’isolationnisme américain égoïste et sans complexes devrait commencer pour de bon le 20 janvier 2025.
Vraiment ? L’avenir du multilatéralisme peut-il réellement dépendre des résultats électoraux dans un seul pays ? Est-il possible que l’architecture complexe et riche des institutions internationales et des mécanismes de coopération mondiale aient reçu le coût de grâce de manière aussi soudaine ? N’y a-t-il donc aucun espoir pour l’avenir de l’ordre multilatéral ?
Trump 2.0 rend nécessaire d’affirmer un Multilatéralisme 2.0 : un multilatéralisme qui ne dépende pas des sautes d'humeurs d’un pays, quel qu’il soit.
Bien sûr que si ! Trump 2.0 rend nécessaire d’affirmer un Multilatéralisme 2.0 : un multilatéralisme qui ne dépende pas des sautes d'humeurs d’un pays, quel qu’il soit.
Un raz-de-marée électoral ? Pas tout à fait
La victoire de Trump a été présentée comme une vague rouge, un coup décisif ayant mis l’adversaire à terre. Pour la première fois depuis 2004, le candidat républicain a remporté le vote populaire, s’assurant un soutien croissant quelque soit la communauté – ethnique, d’âge ou de genre. Et surtout, les Républicains ont réussi le rare « tiercé gagnant » : à partir de janvier 2025, ils contrôleront la Maison Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants. Trump pourra ainsi faire avancer plus facilement son programme, au moins au cours des deux années à venir.
Pourtant, il ne s’agit pas d’un raz-de-marée électoral. Certes, à 312 contre 226, l’écart pour ce qui est du collège électoral est important. Pour ce qui est du vote populaire par contre, Trump a convaincu un peu moins de 50 pour cent du total des suffrages exprimés (autour de 77 millions). On est loin des véritables raz-de-marée électoraux dont avaient bénéficié Ronald Reagan (1984), Richard Nixon (1972) ou Lyndon Johnson (1964). Trump l’a emporté principalement parce qu’avec 74,5 millions de voix le score de Kamala Harris est significativement inférieur au record de 81 millions de votes établi par Joe Biden en 2020.
Avec un taux de participation en baisse, de 65,8 à 63,5 pour cent, il est clair qu’une fois le choc encaissé, les stratèges démocrates ne considèreront pas ce résultat comme un échec définitif mais bien comme la conséquence d’une incapacité à mobiliser les soutiens démocrates. Le résultat sera interprété comme la conséquence d’une part du changement de candidat à la dernière minute et, d’autre part, du climat économique défavorable, Mais le jeu politique américain se poursuivra, toujours aussi polarisé.
Ceci étant dit, il est impossible de nier que Trump et les Républicains seront fermement aux commandes le 20 janvier 2025. L'impact à court terme sur l’Amérique et le monde dans son ensemble sera considérable.
Les craintes en matière de politique étrangère
Compte tenu de son caractère imprévisible, il est difficile d’évaluer l’impact à venir de Trump sur la politique étrangère des États-Unis. Il fera certainement pression en faveur d’accords de paix en Ukraine et au Moyen-Orient (tout en ignorant très probablement les conflits oubliés, tel celui qui fait rage au Soudan). Sur le plan économique, la nouvelle administration emploiera la manière forte en mettant en œuvre de nouveaux droits de douane ciblant spécifiquement la Chine, une impulsion menée par le futur secrétaire d’État, Marco Rubio. Mais le programme « Make America Great Again » est si vaste qu’il peut rapidement générer de l’inertie et aboutir à une impasse au niveau national. La rafle et la déportation des immigrants clandestins, par exemple, impliquerait un coût en ressources et en capital politique difficilement imaginale. Une attaque massive contre la bureaucratie fédérale pourrait facilement avoir un effet contre-productif.
Trump bien sûr se démarquera de son prédécesseur, mais il est important de souligner qu'il est loin d’être le premier président à vouloir donner la priorité à l’Amérique et à abandonner en conséquence les institutions multilatérales. Jimmy Carter, Ronald Reagan et George W. Bush avaient tous fait le même choix. Comme la plupart de ses prédécesseurs depuis les années 1960, Barack Obama a réclamé un partage plus équitable de la charge financière entre les alliés au sein de l’OTAN. Au cours des huit décennies écoulées, les États-Unis ont pratiqué une sorte de multilatéralisme à la carte. Trump sera certainement le pratiquant le plus extrême de cette « doctrine ». Mais il sera impossible de dire que nous n’étions pas avertis !
Trump bien sûr se démarquera de son prédécesseur, mais il est important de souligner qu'il est loin d’être le premier président à vouloir donner la priorité à l’Amérique et à abandonner en conséquence les institutions multilatérales. Jimmy Carter, Ronald Reagan et George W. Bush avaient tous fait le même choix. Comme la plupart de ses prédécesseurs depuis les années 1960, Barack Obama a réclamé un partage plus équitable de la charge financière entre les alliés au sein de l’OTAN. Au cours des huit décennies écoulées, les États-Unis ont pratiqué une sorte de multilatéralisme à la carte. Trump sera certainement le pratiquant le plus extrême de cette « doctrine ». Mais il sera impossible de dire que nous n’étions pas avertis !
Au bout du compte, le fait est que le multilatéralisme ne peut dépendre pour sa survie des fantaisies et des souhaits d'un groupe relativement restreint d’électeurs.
Au bout du compte, le fait est que le multilatéralisme ne peut dépendre pour sa survie des fantaisies et des souhaits d'un groupe relativement restreint d’électeurs. Des modifications à la marge dans l’équilibre électoral d’États comme la Pennsylvanie, le Michigan ou le Wisconsin ont été déterminantes pour l’issue du processus politique interne américain. Mais la panique apparente que l’élection de Trump a provoquée chez les défenseurs du multilatéralisme n’est pas seulement étrange : elle devrait être le tout dernier signal d’alarme.
Vers un Multilatéralisme 2.0
La leçon de l’élection de Trump pour l’avenir du multilatéralisme est claire. La dépendance à l’égard des largesses américaines, récemment documentée dans les pages de cette publication, ne peut représenter une base solide pour le multilatéralisme ou la gouvernance mondiale. Au XXIe siècle, la Genève internationale a été financée de manière disproportionnée par les États-Unis (à plus de 26 pour cent entre 2000 et 2020). D’autres acteurs doivent intensifier leurs efforts.
Il est également clair qu’une transformation plus fondamentale sera nécessaire pour que le multilatéralisme se développe et ne se contente pas de survivre. Le multilatéralisme de demain ne peut être un projet majoritairement « occidental ». Il ne suffira pas que les pays du G7 mobilisent les sommes nécessaires si les États-Unis devaient réduire de manière drastique leurs financements. La légitimité du système en souffrirait. Les Nations Unies et la Genève internationale seraient confrontées à un moment de type « Société des Nations » : une perte de légitimité et de pertinence, menant à une dissolution potentielle.
Heureusement il n’est pas trop tard pour agir. Nous devons reconnaître que l’idée d’un système international libéral en expansion constante et bâti sur le soutien financier bienveillant des États-Unis est irréaliste. Pourtant, si une alternative crédible et cohérente tarde à se matérialiser – penser aux BRICS en ce sens semble une proposition discutable en 2024 – la possibilité de construire un système multilatéral plus inclusif est à portée de main. La nécessité d’un tel projet s’impose de plus en plus que ce soit dans les pays du nord comme dans les pays du sud.
Il est indéniable que le multilatéralisme n’aura pas d’avenir s’il ne réussit pas sa transformation vers plus d’inclusion.
Le défi est de taille. Il est indéniable que le multilatéralisme n’aura pas d’avenir s’il ne réussit pas sa transformation vers plus d’inclusion. Cela ne nécessite pas forcément la création de nouvelles institutions ou organisations, elles sont déjà légion ! Il n’est même pas forcément question d’un appel à révolution ou d’une remise en cause complète. Mais deux éléments sont nécessaires : le partage de la charge du financement et le partage du pouvoir. L’un ne peut s’envisager sans l’autre. Penser qu’un financement supplémentaire émergera d’une projection purement altruiste serait un leurre.
L’élection de Donald Trump ne sonne pas le glas du multilatéralisme et de la gouvernance mondiale. Mais la réaction paniquée à son retour à la Maison Blanche nous rappelle à l’évidence. L’avenir du multilatéralisme ne peut dépendre des courants politiques d'un seul pays, peu importe son degré de richesse et de puissance. Il ne faut pas baisser les bras. Au contraire, il nous faut saisir l’opportunité du moment pour commencer à construire un système multilatéral plus inclusif.
À propos de l’auteur
Jussi Hanhimäki est professeur d’histoire et politique internationales au Geneva Graduate Institute. ().
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les points de vue du Geneva Policy Outlook ou de ses organisations partenaires.