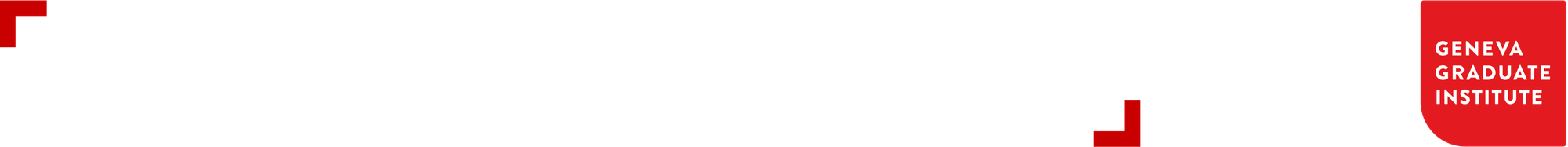Par Aditya Bharadwaj
La fertilité humaine connaît un déclin régulier à l’échelle mondiale, générant des inquiétudes aussi bien au sein de la communauté scientifique que de celle de l’élaboration des politiques. En plus de facteurs bien connus tels que les déséquilibres hormonaux, les polluants environnementaux ou les évolutions des modes de vie, un problème relativement nouveau, mais pressant, a émergé : celui des microplastiques. Ces minuscules particules de plastique mesurant moins de 5 mm ont envahi les écosystèmes ; on en a retrouvé dans le corps humain, et notamment le sang, le placenta et les organes reproducteurs. Certaines données scientifiques suggèrent que les microplastiques pourraient avoir un impact significatif sur la fertilité humaine, affectant potentiellement la santé et la stabilité socio-économique de la population.
Les microplastiques et la santé reproductive : petites particules, mais grandes conséquences
Les microplastiques sont issus de la dégradation de plus grands articles en plastique et de la production délibérée de microbilles à des fins industrielles. Ces petites particules manufacturées sont utilisées pour fabriquer des objets quotidiens, des cosmétiques aux applications médicales. Elles peuvent pénétrer dans l’organisme humain via l’ingestion, l’inhalation ou l’absorption par la peau. Leur petite taille leur permet de traverser les membranes cellulaires et de s’accumuler dans les tissus. Au-delà de leur présence physique, l’impact des microplastiques est exacerbé par l’exposition liée au mode de vie aux perturbateurs endocriniens chimiques tels que le bisphénol A (BPA) ou les phtalates, imitant la signalisation hormonale ou interférant avec celle-ci. Les recherches menées sur les effets des microplastiques sur la fertilité basées sur des modèles animaux ont révélé des tendances préoccupantes. Par exemple, des souris femelles exposées aux microplastiques ont présenté une réduction de la fonction ovarienne, une perturbation des cycles menstruels et une détérioration de l’implantation embryonnaire. Les recherches sur la fertilité masculine ont montré une réduction de la qualité du sperme, y compris une baisse de la motilité et de la concentration, outre une augmentation des dommages à l’ADN. Si les études impliquant directement des humains restent limitées, ces conclusions démontrent le potentiel de troubles significatifs de la reproduction.
Le déclin des taux de fertilité et les microplastiques : une intersection négligée
À l’échelle de la planète, les taux de fertilité déclinent rapidement. En 2020, le taux moyen de fertilité mondial avait chuté à 2,3 enfants par femme, contre 5,0 en 1960. Ce déclin est principalement attribué à des facteurs socio-économiques tels que l’âge plus tardif des grossesses, les pressions financières ou le renforcement de l’accès à la contraception. Toutefois, il convient de ne pas négliger le rôle des facteurs environnementaux, y compris des microplastiques, dans l’exacerbation de l'infertilité.
En dépit d'un corpus de données scientifiques croissant, la relation entre les microplastiques et la fertilité demeure sous-explorée à la fois dans la recherche scientifique et les cadres politiques.
La découverte de microplastiques dans le placenta humain met en avant une voie critique par laquelle ces particules pourraient avoir une incidence sur le développement fœtal et la santé maternelle. Des microplastiques ont été détectés dans le placenta de femmes caractérisées par des grossesses normales, donnant lieu à des inquiétudes quant à leur impact potentiel sur la croissance embryonnaire et le développement du système immunitaire. En outre, la présence généralisée des microplastiques dans la nourriture, l’eau et l’air met en lumière à quel point il est difficile d’éviter l’exposition. Toutefois, en dépit d'un corpus de données scientifiques croissant, la relation entre les microplastiques et la fertilité demeure sous-explorée à la fois dans la recherche scientifique et les cadres politiques. Les politiques et organisations axées sur la fertilité se concentrent traditionnellement sur les interventions socio-économiques et médicales visant notamment à améliorer l’accès aux traitements des troubles de la fertilité ou à jouer sur les facteurs liés au mode de vie.
En parallèle, les initiatives politiques relatives aux microplastiques se concentrent principalement sur les impacts environnementaux et les stratégies de gestion des déchets, négligeant souvent les implications pour la santé humaine. Cette bifurcation crée un angle mort critique qui entrave l’élaboration de politiques efficaces. Par exemple, les cadres politiques internationaux qui traitent des microplastiques, tels que les résolutions prises par l’Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (ANUE), incluent rarement dans leur périmètre les implications liées à la fertilité ou à la santé humaine plus large. En raison d'une absence d’approches intégrées, aucune des communautés n’est suffisamment préparée pour s’attaquer à l’intersection de ces problématiques.
Combler les lacunes dans la recherche
Les éléments évoqués précédemment soulignent qu’il est urgent de donner priorité à certains domaines de recherche. Bien que les recherches établissant un lien entre les microplastiques et l’infertilité se développent, de nouvelles conclusions mettant en avant des voies de dommage telles que le stress oxydatif, l’inflammation ou la perturbation endocrinienne, des études longitudinales menées sur des humains sont instamment requises pour corroborer les données scientifiques fondées sur les animaux et quantifier les risques. Le fait que le public ait de plus en plus conscience des microplastiques présente une opportunité de plaidoyer. A pareille mesure, les campagnes peuvent profiter de cette prise de conscience pour mettre en avant les risques potentiels pour la fertilité, stimulant ainsi la demande de mesures réglementaires plus strictes. Les avancées florissantes des technologies analytiques telles que la spectrométrie ou la microscopie permettent une détection et une caractérisation plus précises des microplastiques, ce qui pourrait s’avérer crucial pour évaluer les niveaux d’exposition et les corréler avec les résultats en matière de fertilité. En d’autres termes, le renforcement des initiatives de recherche est essentiel pour combler les lacunes de connaissances. Les collaborations interdisciplinaires impliquant les sciences biologiques ainsi qu'une gamme de sciences sociales doivent donner la priorité aux études à long terme qui se penchent sur l’impact des microplastiques sur la fertilité humaine. Le soutien d’organisations telles que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) pourrait permettre de pérenniser les études épidémiologiques à grande échelle et la recherche innovante en laboratoire. Des partenariats entre universités et industries pourraient favoriser encore davantage la mise au point de matériaux biodégradables afin de réduire la pollution future aux microplastiques.
Le rôle de Genève pour créer des passerelles entre la politique relative aux microplastiques et celle liée à la fertilité : un appel à l’action
En tant que pôle de l’élaboration de politiques internationales, Genève est bien positionnée pour défendre une approche coordonnée. Par exemple, une résolution de l’ANUE de 2025 pourrait créer un lien explicite entre les microplastiques et la santé humaine, mandatant des études sur les impacts sur la fertilité et appelant à des limites plus strictes concernant les perturbateurs endocriniens chimiques. Les organisations centrées sur la fertilité telles que la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie (ESHRE) ou l’American Society for Reproductive Medicine (ASRM) devraient collaborer avec les Nations Unies et les agences environnementales internationales afin d’intégrer les risques liés aux microplastiques aux agendas en matière de santé reproductive. En outre, les campagnes de santé publique doivent vulgariser les risques des microplastiques pour la fertilité , et les formations professionnelles dispensées aux prestataires de santé devraient intégrer les données scientifiques émergentes, permettant aux praticiens de guider les patients quant à la minimisation de l’exposition. Les écoles et universités pourraient inclure ce sujet aux programmes afin de favoriser la conscience sociétale sur les effets nocifs des microplastiques sur le long terme.
Par ailleurs, les décideurs politiques pourraient promouvoir la mise au point de matériaux durables et de technologies de filtration des microplastiques en échange d’’avantages fiscaux ou de subventions. Par exemple, le financement d'innovations dans le traitement des eaux usées pourrait réduire les fuites de microplastiques dans les systèmes d’approvisionnement en eau, réduisant ainsi indirectement l’exposition humaine. L’accélération des mesures telles que l’élimination des plastiques à usage unique ou l’interdiction de produits spécifiques contenant des microplastiques, qui sont déjà mises en œuvre progressivement, pourrait se traduire par des bénéfices immédiats. À cet égard, l’adéquation des réglementations nationales avec les conventions internationales et multilatérales est essentielle pour favoriser une approche unifiée visant l’atténuation de la pollution aux microplastiques.
En 2025 et au-delà, les approches interdisciplinaires innovantes et offrant des collaborations entre les sciences biologiques et les sciences sociales, les initiatives de recherche robuste et les décisions politiques audacieuses seront essentielles pour atténuer ce risque.
Bien qu’elles soient encore en cours de développement, les données scientifiques mettant en lumière le lien entre microplastiques et infertilité humaine sont suffisamment probantes pour justifier l’attention immédiate des chercheurs et décideurs politiques.. Le fossé non comblé entre la communauté des microplastiques et celle des politiques de fertilité laisse l’humanité mal préparée pour répondre à cette menace croissante. En 2025 et au-delà, les approches interdisciplinaires innovantes et offrant des collaborations entre les sciences biologiques et les sciences sociales, les initiatives de recherche robuste et les décisions politiques audacieuses seront essentielles pour atténuer ce risque. , Genève, pôle pour les politiques internationales, pourrait prendre la tête du mouvement en facilitant le dialogue, en élaborant des politiques intégrées et en mobilisant l’action mondiale. Le coût de l’inaction semble trop élevé.
À propos de l’auteur
Aditya Bharadwaj est professeur et directeur de la Chaire anthropologie et sociologie au Geneva Graduate Institute, où il co-dirige également le Gender Centre (« Centre sur le genre »).
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les points de vue du Geneva Policy Outlook ou de ses organisations partenaires.