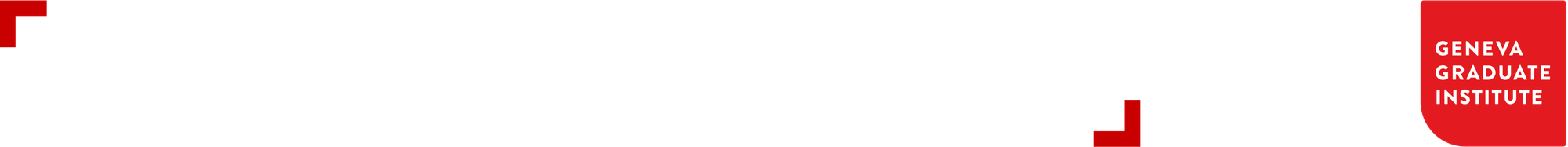Par Heba Aly
Genève s’affirme fièrement comme une capitale du multilatéralisme. Et pourtant, la plupart des discussions qui ont lieu à Genève traitent de la disparition du multilatéralisme. Il est temps de proposer des solutions.
Le multilatéralisme d’aujourd'hui, incarné dans la Charte des Nations Unies, a été conçu en 1945. Pour citer Stephen Heintz, la « logique » des relations internationales était fondée à l’époque sur la domination des grandes puissances, la primauté de l'intérêt national, l’impérialisme, le racisme et le patriarcat. Cette logique divisait le monde entre « gentils » et « méchants » (désignés dans la Charte sous le nom d’« États ennemis ») et opposaient les puissants aux faibles (l’un des organes des Nations Unies créé par la Charte est le Conseil de tutelle, mandaté pour superviser la transition des colonies vers l'indépendance).
Une solution pour mieux aligner le multilatéralisme et ses objectifs est de mettre à jour son fondement constitutionnel, la Charte des Nations Unies.
La Charte des Nations Unies est l’un des rares documents acceptés universellement à l’heure actuelle, ce qui n’est pas négligeable à une époque de fragmentation et de polarisation géopolitiques.
Mais la Charte a toujours eu vocation à être un document vivant.
La Charte, un document vivant
Lors de la conférence internationale de San Francisco où la Charte des Nations Unies a été adoptée, le président des États-Unis, Harry Truman, déclarait : « Cette charte... sera développée et améliorée au fil du temps. Personne ne prétend qu’il s’agisse d'un instrument définitif ou parfait. Elle ne s’inscrit pas dans un modèle immuable. L’évolution du monde impliquera des réajustements. »
Près de 80 ans plus tard, les réajustements n’ont que trop tardé.
Dans un discours fort en faveur d’une réforme de la Charte, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré en septembre 2024, pendant l'Assemblée générale des Nations Unies : « La version actuelle de la Charte ne répond pas aux défis les plus urgents de l’humanité ».
L’objectif premier des Nations Unies était de garantir la paix et la sécurité, mais l’incapacité à mettre fin aux conflits en Ukraine, à Gaza, au Soudan et dans de nombreuses autres parties du monde démontre clairement que notre système de sécurité globale ne fonctionne plus.
En outre, dans la Charte, une troisième guerre mondiale est clairement identifiée comme menace principale pour l’humanité. Bien entendu, le risque n’est pas inexistant. Mais les menaces existentielles associées à l’urgence planétaire et à la croissance non jugulée de l’intelligence artificielle, qui n’apparaissent pas dans le texte de 1945, sont au moins aussi importantes.
Par ailleurs, à l’origine, la Charte n’avait été adoptée que par 50 pays : la majeure partie du continent africain était encore colonisée à l’époque, n’accédant à l’indépendance que dans les années 1950 et 1960. Aujourd'hui, le monde compte 193 pays indépendants.
Elle donne une place centrale à l’État-nation en tant que seul acteur du multilatéralisme, alors que les citoyens, le secteur privé et les autres acteurs non-étatiques jouent désormais un rôle de plus en plus important.
La Charte institutionnalise le pouvoir des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, y compris le Royaume-Uni et la France, deux pays qui, à l’heure actuelle, ont bien moins de poids que par exemple l’Inde, l’Allemagne, le Japon ou le Brésil. Elle donne une place centrale à l’État-nation en tant que seul acteur du multilatéralisme, alors que les citoyens, le secteur privé et les autres acteurs non-étatiques jouent désormais un rôle de plus en plus important.
L’article 109 : une conférence pour la révision de la Charte
Quelles sont donc les voies du changement ?
L’une d’entre elles est inscrite dans la Charte des Nations-Unies elle-même.
En 1945, la majorité des signataires de la Charte était opposée au droit de veto accordé aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Pourtant, comme l’explique Mahmoud Sharei, ils ont accepté de signer, convaincus par la « promesse de Nations Unies plus démocratiques à l’avenir ».
Cette « acceptation conditionnée », pour reprendre les termes de M. Sharei, fut inscrite dans l’article 109 de la Charte, qui appelle à la tenue d'une conférence générale aux fins d’une révision de la Charte dans un délai de 10 ans à compter de la création des Nations Unies.
Cette promesse n’a jamais été tenue.
Si l'idée de rouvrir, aujourd’hui. la discussion autour de ce texte fondateur peut sembler étrange, un coup d'œil aux propositions du Global Governance Forum sur ce à quoi pourrait ressembler une « Seconde Charte des Nations Unies » montre clairement qu’il y aurait beaucoup plus à gagner qu’à perdre.
Une Charte révisée permettrait de projeter un monde qui partage le pouvoir de manière équitable, qui gouverne mieux la crise climatique et autres menaces émergentes, qui reconnaît notre interdépendance, rend les Nations Unies plus démocratiques
Une partie importante de la Charte actuelle devrait être conservée. Cependant, une révision permettrait de projeter un monde qui partage le pouvoir de manière équitable, qui gouverne mieux la crise climatique et autres menaces émergentes, qui reconnaît notre interdépendance, rend les Nations Unies plus démocratiques en créant un parlement mondial semblable au Parlement européen, et place « Nous, les peuples », plutôt que les États, au centre de la gouvernance mondiale. Bien que l’on puisse légitimement craindre de « jeter le bébé avec l’eau du bain », le dispositif de l’article 109 offre un mécanisme de protection fiable puisque la nouvelle Charte se devrait d’être ratifiée par une majorité de gouvernements, ainsi que par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, pour entrer en vigueur (voir ici pour davantage de réponses aux préoccupations courantes au sujet de la réforme de la Charte).
Les efforts de longue date pour réformer la Charte ont connu un nouvel élan dans la période précédant le Sommet du Futur des Nations Unies en septembre 2024, où tous les États ont adopté une série d’engagements visant à renouveler le multilatéralisme.
L'idée est soutenue par le Brésil,d'anciens chefs d'État, des diplomates et des lauréats du prix Nobel allant de la journaliste Maria Ressa à l’ancien président du Costa Rica José-María Figueres-Olsen, de l’ancien ambassadeur kényan aux Nations Unies Martin Kimani au conseiller principal et premier responsable du gouvernement intérimaire du Bangladesh Muhammad Yunus, ainsi que par le Conseil consultatif de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies sur un multilatéralisme efficace, qui a appelé à invoquer l’article 109 dans son rapport qui fera date.
Une Coalition pour la réforme de la Charte des Nations Unies récemment lancée mobilise aujourd’hui les États Membres pour les inciter à convoquer une conférence générale aux fins d’une révision de la Charte des Nations Unies. Elle vise à rallier à sa cause plus de 100 organisations de la société civile et 6 États Membres en 2025.
Cet effort se heurtera à de nombreux obstacles, mais étant donné qu’une large partie du monde n’est pas bien servie par l’ordre mondial actuel, un nouveau système pour gouverner le monde est inévitable.
« Je ne me fais pas d’illusions, a reconnu le président Lula dans son discours, quant à la complexité d'une réforme telle que celle-ci, qui se heurtera aux intérêts bien compris en faveur du statu quo. Elle nécessitera un énorme effort de négociation. Mais il en va notre responsabilité. »
Lula poursuit : « Nous ne pouvons pas attendre une autre tragédie mondiale telle que la Deuxième Guerre mondiale pour ne construire qu’à ce moment-là, sur les ruines, une nouvelle gouvernance. »
Ceux qui détiennent le pouvoir dans l’architecture internationale actuelle ont également une raison plus concrète de s’engager dans une réforme. Ils ont tout intérêt à renégocier la répartition des pouvoirs dans la Charte des Nations Unies maintenant, alors qu’ils disposent encore d’un avantage relatif. Les mutations du pouvoir réel sont déjà en cours et seront probablement accélérées par la présidence de Donald Trump aux États-Unis. Au cours des 10 ou 20 prochaines années, les nouvelles puissances pourraient tout simplement créer leurs propres institutions, ou tout au moins disposer d'un pouvoir de négociation plus important.
Quel rôle pour Genève ?
Avec une contribution totale de 805 millions de dollars aux Nations Unies en 2023, la Suisse se place au treizième rang des contributeurs à l’organisation. Compte tenu de l'importance de son investissement, la Suisse a tout intérêt à rendre les Nations Unies plus efficaces.
Genève, en particulier, accueille un siège des Nations Unies, 181 États, 40 organisations internationales (y compris des agences spécialisées des Nations Unies telles que l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés ou l’Organisation mondiale de la Santé) et 461 ONG. Cette concentration crée un terreau fertile pour un débat multipartite quant aux fondements des relations internationales du futur.
Dans la ville des droits de l’homme, de l’humanitaire et de l’élaboration de politiques de santé, les acteurs de Genève connaissent plus intimement qu’à New York l’impact dans la vraie vie des défaillances de la gouvernance mondiale.
Par rapport au siège principal des Nations Unies à New York, l’environnement moins politisé de Genève se prête mieux à l’incubation d'idées audacieuses pour l’avenir du multilatéralisme. Dans la ville des droits de l’homme, de l’humanitaire et de l’élaboration de politiques de santé, les acteurs de Genève connaissent plus intimement qu’à New York l’impact dans la vraie vie des défaillances de la gouvernance mondiale. C’est peut-être pour cette raison que les ambassadeurs d’ici semblent plus enclins à servir les intérêts collectifs plutôt que nationaux.
Des améliorations normatives devront tôt ou tard être apportées à la Charte des Nations Unies. La neutralité historique de la Suisse et la mosaïque internationale inscrite à Genève permettent à la confédération helvétique et à l’écosystème de la « Genève internationale » qu’elle entretient de jouer un rôle moteur pour insuffler une nouvelle vie à ce document ô combien crucial.
À propos de l’auteur
Heba Aly est la coordinatrice de la Coalition pour la réforme de la Charte des Nations unies, conseillère principale à la Coalition for the UN We Need et ancienne PDG de The New Humanitarian.
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les points de vue du Geneva Policy Outlook ou de ses organisations partenaires.