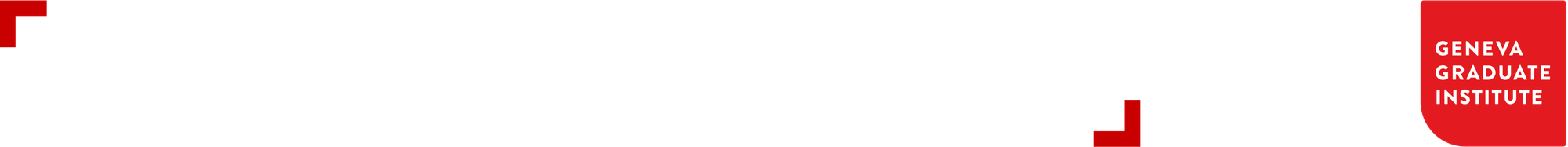Par Richard Gowan
Au cours des discussions sur le Pacte pour l'avenir cette année, les négociateurs se sont souvent inquiétés de l’insignifiance notable de la partie du texte consacrée à la paix et à la sécurité. Lorsque le Secrétaire général António Guterres a lancé le processus du Sommet de l’avenir en 2021, il a minimisé les préoccupations internationales en matière de sécurité, se concentrant plutôt sur la technologie et l’économie. Dans le sillage de l’agression totale de la Russie contre l’Ukraine, les diplomates ont eu le sentiment qu’il était important que le Pacte aborde les questions de sécurité. Mais peu d’entre eux pouvaient envisager dans ce domaine beaucoup de thèmes sur lesquels il était possible de parvenir à un consensus.
Le Pacte pour l'avenir fournit un menu d’options à la carte pour aider le Secrétariat et les États Membres des Nations Unies à renforcer la coopération.
Malgré ces faibles ambitions, le Pacte a surpassé les attentes. Le chapitre 2 du document contient un ensemble de priorités à honorer, rarement très originales, pour le renforcement de la gestion de crises et du désarmement des Nations Unies. Le chapitre 5 inclut une formulation contre toute attente exhaustive sur la nécessité d’une réforme du Conseil de sécurité, ainsi que des références positives aux rôles de la Commission de consolidation de la paix et de l’Assemblée générale sur les questions relatives à la paix et à la sécurité. Le Pacte ne propose aucun concept révolutionnaire sur le maintien de la sécurité internationale. Cependant, il fournit un menu d’options à la carte pour aider le Secrétariat et les États Membres des Nations Unies à renforcer la coopération.
Un pacte dans le contexte d’ordres internationaux en pleine mutation
La plupart de ces options font référence aux mécanismes et processus des Nations Unies déjà existants, et encouragent les États à les faire progresser un peu plus rapidement. La mesure 21 inclut un appel au Secrétaire général à entreprendre « une étude sur l’avenir de toutes les formes d’opérations de paix des Nations Unies ». Cela reflète un sentiment grandissant chez les diplomates basés à New York que les Nations Unies ont récemment sous-estimé la valeur des opérations de maintien de la paix des Casques bleus et des missions politiques spéciales. Les mesures 18 et 44 adoptent des étapes pour renforcer l’architecture de la consolidation de la paix des Nations Unies, ce qui tombe à pic, étant donné que les États Membres passeront en revue le travail de la Commission de consolidation de la paix et des mécanismes connexes en 2025. La formulation du Pacte sur les différentes questions, y compris l’agenda relatif aux femmes, à la paix et à la sécurité et le désarmement, réitère l’importance des engagements existants des États.
Cela ne signifie pas que le Pacte est entièrement rétrograde. La mesure 22 est un appel suggestif, quoique non spécifique, à un renforcement de la coopération internationale sur la sécurité maritime. Si cela n’est pas sans précédent (le Conseil de sécurité avait par exemple traité de la piraterie au large de la Corne de l’Afrique et du golfe de Guinée), cela pourrait tout de même constituer un tremplin pour de nouvelles initiatives dans le sillage des récentes crises en mer Noire et en mer Rouge. La mesure 27 repousse les limites (bien que timidement) de la nécessité d’intensifier les efforts de réponse aux failles de sécurité des nouvelles technologies, particulièrement le danger de la course aux armements dans l’espace.
Que signifie le Pacte pour l’avenir de la Genève internationale ?
Pour les personnes lisant le Pacte dans les agences humanitaires à Genève, le texte contient des passages utiles sur la nécessité de promouvoir la protection des populations civiles en temps de conflit (Mesure 14) et de mieux répondre aux urgences humanitaires (Mesure 15). Toutefois, les deux paragraphes reprennent fondatementalementles engagements internationaux existants dans ces domaines sans formuler de suggestions concrètes sur la manière de persuader les États et les groupes armés non-étatiques de respecter les lois et les normes internationales humanitaires. La mesure 15 reconnaît la nécessité de renforcer les financements en faveur de la réponse humanitaire, mais n’offre aucune orientation sur les moyens de débloquer ces fonds. Le Pacte constitue ainsi un outil de plaidoyer utile pour permettre à la communauté humanitaire de répondre à ses difficultés, mais pas une feuille de route pour les résoudre.
Le Pacte propose également une poignée de solutions pour les experts des droits de l’homme souhaitant affirmer l’importance des approches fondées sur les droits vis-à-vis de la prévention et de la résolution des conflits, mais elles ne sont pas substantielles. Le texte fait fréquemment référence à l’importance du droit international relatif aux droits de l’homme. Il n’inclut pas, cependant, de discussion approfondie sur la manière dont l’architecture relative aux droits de l’homme des Nations Unies pourrait faire davantage pour répondre aux risques liés aux conflits. Cependant, lors de l’Assemblée générale et la Commission de consolidation de la paix, le Pacte principal utilise un langage positif sur le Conseil de sécurité mais en omettant le Conseil des droits de l’homme (celui-ci est brièvement évoqué à une seule reprise dans le Pacte numérique mondial, qui est annexé au texte principal). Les pays occidentaux ont également accepté de modérer un appel à l’examen des besoins en matière de ressources du Haut-Commissariat aux droits de l'homme en raison d’objections de la Russie.
La communauté des droits de l'homme devra donc faire preuve de créativité dans sa manière d'interpréter le Chapitre 2 du Pacte (il y a d’autres aspects intéressants pour la communauté dans d’autres parties du Pacte). Une opportunité intéressante peut se trouver dans la mesure 18, appellant les États à développer et à mettre en œuvre les « stratégies et approches nationales de prévention existantes pour pérenniser la paix ». C’est avant tout une accroche pour pousser la communauté de la consolidation de la paix à faire pression pour obtenir des ressources pour les initiatives de prévention et de réduction des conflits. Cependant, il est également tentant de défendre que le respect des droits de l’homme constitue une composante essentielle pour pérenniser la paix (cela se superpose à la mesure 7 du Chapitre 1 du Pacte, qui met l’accent sur les objectifs de développement durable pour la construction de « sociétés pacifiques, justes et inclusives » et accorde une place centrale aux droits de l’homme). De nombreux diplomates basés à New York reconnaissent l’appel du Pacte en faveur des stratégies de prévention nationales comme un encouragement pour la mise au point de politiques, et il serait logique que ceux-ci se coordonnent avec leurs homologues genevois pour déterminer comment étoffer cette possibilité.
Les implications des formulations linguistiques du Pacte sur le désarmement pour la diplomatie basée à Genève sont plus aisées à percevoir. Les mesures 25, 26 et 27 abordent toute une gamme de questions liées au désarmement allant de la non-prolifération nucléaire à la militarisation des nouvelles technologies. Certaines de ces formulations, telles que celles sur les questions nucléaires, n’ajoutent que peu d’éléments nouveaux aux accords existants. Toutefois, la mesure 27, centrée sur l’actualisation de l’architecture du désarmement des Nations Unies pour répondre aux avancées technologiques récentes, offre une série d’amorces pour les initiatives en matière de politiques dans ce domaine.
Les diplomates, fonctionnaires et représentants de la société civile de New York et de Genève devraient se tourner vers le Pacte pour l’avenir en tant que point de départ de l’esprit d’entreprise politique sur les questions de paix et de sécurité.
Quelque soit le domaine précis dans lequel ils exercent leur fonction, les diplomates, fonctionnaires et représentants de la société civile de New York et de Genève devraient se tourner vers le Pacte pour l’avenir en tant que point de départ de l’esprit d’entreprise politique sur les questions de paix et de sécurité. Le texte contient peu (si ce n’est aucune) de réponses définitives aux crises majeures et aux tendances inquiétantes de la sécurité internationale actuelle. Cependant, il inclut certaines idées et expressions que des penseurs politiques intelligents peuvent utiliser pour faire progresser leurs agendas spécifiques.
À propos de l'auteur
Richard Gowan supervise le travail de plaidoyer de Crisis Group aux Nations Unies, travaillant en collaboration avec les diplomates et les fonctionnaires des Nations Unies à New York.
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les points de vue du Geneva Policy Outlook ou de ses organisations partenaires.