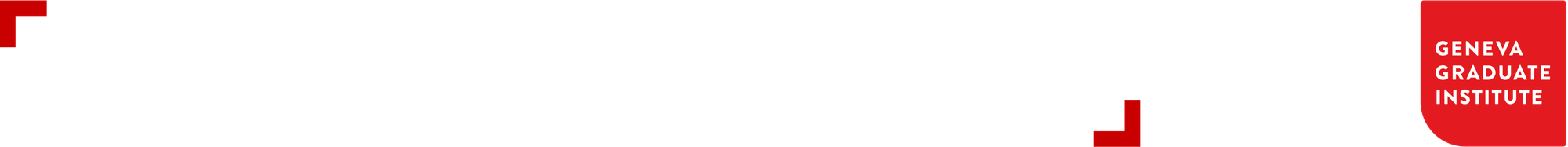Par Achim Wennmann
« Tout est possible dans les moments exceptionnels », disait Jean Monnet, qui fut l’un des pionniers de la construction d'une Europe unie après la Deuxième Guerre mondiale. Mais saisir l’opportunité du changement exige de l’anticipation, de la préparation et un projet clair. Le Geneva Policy Outlook 2025 se projette dans cette direction, soulignant que Genève a tout ce qu'il faut pour saisir le « moment exceptionnel » afin de réinventer le multilatéralisme.
Néanmoins, cette réinvention a lieu à une période où l’esprit du temps politique est défini par un profond scepticisme à l’égard de la coopération internationale, une tendance qui s’affirme encore plus avec les récentes élections américaines. Étant donné les réalités d'un « multilatéralisme en crises » et les perspectives en matière de financement qui, il faut en convenir, sont préoccupantes, le message pour 2025 est clair : pour que Genève conserve sa pertinence, il faut sortir du statu quo.
C’est pourquoi l’édition de cette année met en avant des idées et des pratiques courageuses qui peuvent aider Genève (et plus largement le multilatéralisme) à continuer d’affirmer sa pertinence comme pôle mondial pour la diplomatie et la coopération internationale. Le GPO25 met également en évidence des exemples d’entrepreneuriat politique dans les domaines des droits de la propriété intellectuelle, de la diplomatie de la santé, de la biodiversité et de la consolidation de la paix mais aussi sur les enjeux du futur que nous devons prendre au sérieux.
Vers un Multilatéralisme 2.0
Dans une période troublée sur la scène internationale, la première partie insiste sur la nécessité d’une analyse pondérée des tensions entre stabilité et changement pour guider la prise de décisions. Comme l’affirmait l’ancien Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, une telle approche est indispensable pour réussir à gérer les situations de crises quelles qu’elles soient.
Jussi Hanhimäki suit ce sage conseil. Il démystifie les élections américaines et leurs implications pour Genève en les inscrivant dans une lecture plus large de la politique étrangère des États-Unis. En tant que superpuissance, les États-Unis ont traditionnellement résisté à l’idée qu’ils devaient rendre des comptes aux institutions internationales ou partager la responsabilité de la gestion des problèmes mondiaux. Cette attitude sera probablement amplifiée par la prochaine administration états-unienne, affirmant un « multilatéralisme à la carte ». Jussi Hanhimäki propose de répondre à Trump 2.0 par un Multilatéralisme 2.0, en partant d’un constat simple : « l’avenir du multilatéralisme ne peut dépendre des courants politiques d'un seul pays, peu importe son degré de richesse et de puissance ». Les implications pratiques d’un tel argument doivent être une intensification de l’action diplomatique autour des questions de responsabilité financière, et donc de répartition du pouvoir, en vue de construire un système multilatéral plus inclusif : un « Multilatéralisme 2.0 ».
Hugo Slim transpose la discussion sur la réinvention du multilatéralisme pour la placer dans le contexte genevois de l’élaboration des politiques mondiales. Selon lui, Genève devrait « approfondir (s)a doctrine de l’humanité » - jusqu’alors structurée par une diplomatie des droits humains, de la santé ou de l’humanitarisme – en intégrant radicalement son « angle mort (…) la nature ». La réinvention du multilatéralisme genevois doit reconnaître « l’identité et les intérêts qui nous lient à la communauté terrestre plus large des végétaux et des animaux, ainsi qu’à l’ensemble des écosystèmes terrestres». Qu'il s'agisse de mettre l'accent sur l'initiative « Une seule santé » ou de négociations de paix autour de ressources communes, telles que l'eau ou les écosystèmes, des efforts pratiques pour partir d’une doctrine plus intégrée de l'humanité sont déjà en cours. Pourtant, Genève aurait intérêt à être encore plus proactive en franchissant un cap – celui de faire passer la nature « d’observateur permanent » à « membre permanent de la Genève internationale ».
Marie-Laure Salles développe cette ligne d’argumentation en proposant que l’avenir de Genève comme pôle mondial doit se structurer autour d’un nouvel agenda pour la durabilité. Cet agenda devrait intégrer trois projets de reconnexion : reconnexion de l’humanité avec la nature, reconnexion des êtres humains entre eux et, enfin, reconnexion de chacun.e d’entre nous avec notre humanité. Ce nouvel agenda pour la durabilité peut construire sur de nombreuses initiatives déjà existantes et se doit de mobiliser très largement. Il s’agit de porter un nouvel élan, un nouveau paradigme qui affirme des logiques régénératives, la nécessaire réinvention du contrat social et une orientation technologique qui mette l’humain et la planète au centre. Genève a ici un rôle tout particulier à jouer en réaffirmant son « esprit » - celui qui se définit par une projection « humaniste courageuse combinée à une logique de collaboration internationale ». Marie-Laure Salles conclut que « Genève a tous les atouts pour se réimaginer en tant que pôle essentiel de cette transition historique. (...) C’est un appel que nous ne pouvons pas manquer ! »
Pour Heba Aly, un système multilatéral réinventé a également besoin d’une actualisation de son document fondateur. Elle se penche sur une nouvelle initiative visant à actualiser la Charte des Nations Unies en partant de son Article 109. Heba Aly décrit la motivation à l’origine de ce mouvement collectif qui prend de l’ampleur. Elle souligne que ce projet « rencontrera de nombreux obstacles ». Mais, « étant donné les larges zones du monde qui ne sont pas favorisées par l’ordre mondial actuel », il est clair qu’un « nouveau système pour gouverner le monde est inévitable ». En tant que pôle mondial moins politisé que New York, Genève « se prête à l’incubation d'idées audacieuses pour l’avenir du multilatéralisme », y compris celles qui explorent la possibilité d’apporter des améliorations normatives à la Charte des Nations Unies. Une « Charte des Nations Unies 2.0 » pourrait également constituer une piste permettant à une plus jeune génération de découvrir et de se mobiliser pour la coopération internationale.
Solomon Dersso met en avant la nécessité d'un multilatéralisme en réseau qui, dans le cas de l’Afrique, pourrait faire progresser davantage encore le pouvoir d’action politique grandissant de ce continent. Plus précisément, il suggère de renforcer le lien entre les deux pôles : Addis-Abeba, en tant que pôle régional pour la région africaine et Genève en tant que pôle mondial, contribuant à un multilatéralisme plus inclusif et moins centré sur le Nord. Cet effort « tirer(ait) parti du rôle de l’U(nion africaine), en mobilisant ses membres pour constituer un bloc de vote majeur aux Nations Unies », et renforcerait les échanges sur les questions de paix et de sécurité, les droits humains et la Zone de libre-échange continentale africaine. L’année 2025 permettra sans doute de tester ces différentes possibilités d’échange dans l’objectif de « construire un multilatéralisme pour le futur qui soit encore plus en réseau ».
Richard Gowan conclut cette première partie en formulant des recommandations à l’intention des entrepreneurs politiques qui souhaitent faire avancer leur agenda au sein du système des Nations Unies. Il recommande de partir du Pacte pour l’avenir des Nations Unies comme instrument de plaidoyer. Si le Pacte n’offre pas une feuille de route concrète pour résoudre les défis mondiaux, il propose en revanche un « menu (…) d’options à la carte » dont les entrepreneurs politiques peuvent se saisir. Il peut être mobilisé, par exemple, par les « experts des droits humains qui souhaitent affirmer l’importance des approches fondées sur les droits pour la prévention et de la résolution des conflits ». Dans l’ensemble, le Pacte peut contribuer à favoriser la concrétisation de grandes ambitions en proposant « des idées et des expressions que des entrepreneurs politiques intelligents peuvent utiliser pour faire progresser leur agenda particulier ».
Le Geneva Policy Outlook 2025 identifie plusieurs étapes structurantes vers un « Multilatéralisme 2.0 ».
En résumé, le Geneva Policy Outlook 2025 identifie plusieurs étapes structurantes vers un « Multilatéralisme 2.0 ». Il s’agit notamment de donner la priorité à l’analyse pondérée des tensions entre stabilité et changement ; d’identifier les angles morts qui exigent notre attention ; d’affirmer au cœur du multilatéralisme un nouvel agenda pour une durabilité intégrée ; de mettre à jour les textes fondateurs pour les adapter aux enjeux actuels ; de structurer un multilatéralisme en réseau qui prenne la mesure des nouveaux espaces du pouvoir d’action politique ; et de stimuler l’esprit d’entrepreneuriat politique au niveau multilatéral. Ces éléments ne permettront pas à eux seuls de construire un « Multilatéralisme 2.0 », mais ils définissent des chantiers importants pour 2025 dans la perspective d’une action décidée en faveur d’une réinvention du multilatéralisme.
La diplomatie en action
La deuxième partie du GPO25 approfondit plusieurs thématiques spécifiques où l’entrepreneuriat politique est testé dans le contexte multilatéral. Ces thématiques ont donné lieu à des échanges et discussions structurées organisés par le GPO tout au long de l’année. Le focus thématique de cette deuxième partie montre que Genève demeure sur de très nombreux sujets d’importance l’une des principales plateformes de diplomatie multilatérale et l’un des principaux laboratoires politiques à l’échelle mondiale. Le potentiel de Genève pour stimuler la réinvention du multilatéralisme est loin d’être négligeable !
Margo A. Bagley se penche sur les négociations visant à aboutir à un consensus autour du Traité de l’OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, connu sous le nom de « traité GRATK ». Elle souligne que l’évolution de l’environnement géopolitique depuis le début de la guerre en Ukraine a permis un certain opportunisme permettant d'accélérer les négociations. En un sens, la guerre en Ukraine a représenté ce « moment exceptionnel » précédemment évoqué dans la citation de Monnet, que les négociateurs ont su saisir pour guider le processus de négociation vers une issue favorable. Le traité GRATK montre la diplomatie traditionnelle à son meilleur, combinant un travail de préparation minutieux, une introduction présidentielle équilibrée, une dynamique habile vers la création de consensus, et le soutien en coulisses de l’OMPI et de nombreux négociateurs. Le succès du traité GRATK montre que les négociations techniques dans le cadre des organisations internationales spécialisées peuvent être l’un des éléments constitutifs forts d’un multilatéralisme réinventé. Ce succès montre en effet qu’une telle diplomatie multilatérale peut fonctionner, même si c’est à son propre rythme, comme c’est le cas ici avec des négociations qui ont duré une dizaine d’années.
Malheureusement, les négociations autour du traité sur les pandémies ne peuvent pas s’offrir le luxe d'un tel calendrier. Suerie Moon souligne que le risque de la prochaine pandémie mondiale devrait être un facteur d’accélération des négociations, mais que malheureusement des questions difficiles font blocage – particulièrement autour des systèmes d’accès aux agents pathogènes et de partage des avantages découlant de leur utilisation (PABS, selon l’acronyme anglais). Le retour d’une administration Trump risque de rendre la situation encore plus difficile. Pourtant, l’hypothèse structurante des négociations demeure : « (l)e monde sera plus sûr si les gouvernements s’accordent sur des règles justes et efficaces pour régir les pandémies en 2025. » Compte tenu du contexte géopolitique et des défis sous-jacents sur des enjeux clés, les négociations autour du traité sur les pandémies offrent à Genève une nouvelle occasion de mettre en œuvre un processus qui déploie la diplomatie multilatérale à son meilleur.
Au-delà de la dynamique des négociations sur des questions spécifiques, Genève continue également de façonner l’initiative diplomatique ailleurs dans le monde. Tony Rinaudo, Juliet Bell et Athena Peralta partagent leur expérience d’amplification et d’intensification en passant d’un programme d’interventions ponctuelles à la construction d’un mouvement. Les auteurs présentent les résultats d’une « approche à faible coût et à haut impact de restauration des terres dégradées par le respect de la végétation existante ». Rien qu’au Niger, la Régénération Naturelle Gérée par les Agriculteurs (FMNR, d’après son acronyme anglais) a permis de restaurer une surface de terres agricoles supérieure au territoire de la Suisse. À l’échelle mondiale, elle a permis de restaurer une superficie quatre fois plus importante. La FMNR constitue également un outil stratégique pour la sécurité alimentaire. Aujourd’hui, cette approche élargit et renforce son impact grâce en particulier à la construction d’un mouvement à ancrage confessionnel qui déploie un plaidoyer politique, notamment sur des questions comme la sécurité foncière, les incitations financières pour les agriculteurs ou l’intégration des questions d’adaptation climatique et de gestion des risques de catastrophe. Pour la communauté de la FMNR, Genève est un amplificateur du processus parce que Genève est une plateforme de politique mondiale, offrant qui plus est un accès privilégié au réseau mondial des leaders religieux.
Hiba Qasas propose une idée audacieuse de l’entrepreneuriat de paix pour Israël et la Palestine. Selon elle, « l’approche actuelle n’a apporté ni la sécurité aux Israéliens, ni la dignité et l’auto-détermination aux Palestiniens ». Le « vrai réalisme à l’heure actuelle est d’affirmer que la paix, loin d’être un luxe idéaliste, est le seul chemin à suivre qui soit pragmatique ». Elle souligne qu’« il y a (…) des partenaires pour la paix dans chacun des camps », avec la volonté de travailler ensemble. Ceux-ci construisent des groupes communs en adoptant cinq principes directeurs : « la reconnaissance mutuelle des deux parties à l’auto-détermination, à l’indépendance et à la condition étatique ; la sécurité et la sûreté ; la dignité ; le pouvoir d’action et l’inclusion ; et la confiance par le biais d’un processus de guérison ». Il est possible aujourd’hui de construire une réalité pour Israël et la Palestine autre qu’un « cycle sans fin de violence », et cette occasion doit être saisie dès aujourd’hui.
Genève est une source ou un accélérateur d'idées audacieuses que l’on peut déployer ailleurs. Favoriser et protéger cet espace sûr pour le développement stratégique, la construction de réseaux et la résolution de problèmes autour d’enjeux, de thématiques et de positions différentes sera un ingrédient essentiel pour maintenir la pertinence de Genève en tant que pôle mondial.
Les deux exemples précédents illustrent le fait que Genève est une source ou un accélérateur d'idées audacieuses que l’on peut déployer ailleurs. Favoriser et protéger cet espace sûr pour le développement stratégique, la construction de réseaux et la résolution de problèmes autour d’enjeux, de thématiques et de positions différentes sera un ingrédient essentiel pour maintenir la pertinence de Genève en tant que pôle mondial.
À surveiller : de nouveaux enjeux
Nombreux sont les enjeux qui pourraient bénéficier d’un tel espace sécurisé pour l’innovation politique ; dans le GPO25, nous mettons en lumière trois de ces enjeux ayant émergé de nos dialogues de l’année écoulée.
Le premier enjeu est celui des« nouvelles ADM : les armes de désinformation massive ». Jean-Marc Rickli met en avant l’importance de stimuler l’action diplomatique pour contrer la machine à désinformation via l’IA. Si elle n’est pas maîtrisée, cette machine risque rien de moins que de complètement bouleverser les démocraties, principalement en « instill(ant) le doute quant à la légitimité des institutions politiques et des résultats des processus démocratiques ». Compte tenu de l’évolution rapide de la trajectoire des technologies de la désinformation, il est temps de mettre au point une réponse multilatérale. « Genève est partciulièrement bien placée pour devenir le pôle mondial pour la gouvernance mondiale en matière de désinformation et pour la création d'un régime émergent sur le contrôle de la subversion » fonctionnant comme un régime de contrôle des armes. De tels efforts souligneraient également que les sujets de la démocratie et de la gouvernance participative ont toute leur place dans l’arsenal des outils diplomatiques de la place de Genève.
Le deuxième enjeu traite d’une diplomatie concrète qui relie les microplastiques, la santé humaine et la stabilité socio-économique. Aditya Bharadwaj lance l’alerte en s’appuyant sur le corpus croissant de données scientifiques issues de la recherche sur l’impact des microplastiques sur la fertilité, qui annonce « un risque potentiel significatif pour les dynamiques de reproduction ». Aditya Bharadwaj souligne que la plupart des initiatives politiques sur les microplastiques sont actuellement centrées sur les impacts environnementaux ou la gestion des déchets, plutôt que sur les impacts en matière de santé humaine. Les écosystèmes de politiques de Genève disposent d'une occasion importante de construire une passerelle entre les microplastiques et les communautés mondiales de la santé afin de mettre au point des politiques intégrées et de créer une alliance mondiale pour l’action.
Le troisième enjeu est « un message du terrain » qui souligne comment des systèmes de crédits carbones mal gérés peuvent contribuer aux conflits communautaires en Afrique. L'objectif du système de crédits carbone est quadruple – il combine la restauration des terres, l’augmentation du revenu des agriculteurs, la séquestration du carbone et l’évolution vers une projection net zéro. Cependant, Irene Ojuok et Alan Channer alertent sur le fait que le financement de l’action climatique peut devenir un facteur de conflit au sein des communautés et des familles, touchant particulièrement les femmes et les jeunes. Ils mettent l’accent sur l’importance de l’intégration des évaluations des risques de conflit aux études de faisabilité du financement de la lutte contre les émissions de carbone, mais aussi du rôle de Genève dans l’amplification de la voix des communautés rurales africaines dans leurs interactions avec les principaux acteurs du monde de l’entreprise impliqués. En lançant ainsi l’alerte, les auteurs démontrent l'importance du suivi continu et de la conception de processus itératifs dans la mise en œuvre du programme du financement de l’action climatique.
En invoquant Jean Monnet dans son article, Marie-Laure Salles affirme le type de leadership qui peut aider Genève dans sa quête de pertinence renouvelée en tant que pôle mondial dans un monde en profonde évolution. Cette quête exige que l’on passe d'une complaisance relative et d’un accent mis sur la continuité à une forme plus active de renouveau, de réinvention et d’innovation pionnière. En tant que pôle mondial, Genève peut assumer le rôle de gardienne des idéaux et des valeurs, créer un espace de confiance pour la diplomatie et faire en sorte que toutes les voix soient entendues et prises en compte dans les processus multilatéraux.
L’année 2025, par conséquent, exige que « tout le monde soit mobilisé » pour que Genève réinvente son rôle dans un nouvel ordre mondial, et pour que la diplomatie multilatérale et la coopération internationale restent les principaux instruments de la politique mondiale.
Ceux qui souhaitent saisir le « moment exceptionnel » actuel pour réinventer le multilatéralisme à Genève peuvent s’appuyer sur les instruments, les réseaux et l’expertise de l’un des principaux pôles mondiaux de l’entrepreneuriat politique. Mais ils devraient le faire maintenant, avant que le financement, le soutien politique et la confiance en soi ne s’alignent dans d’autres capitales pour façonner les agendas de la coopération internationale selon des modalités qui leur sont propres. L’année 2025, par conséquent, exige que « tout le monde soit mobilisé » pour que Genève réinvente son rôle dans un nouvel ordre mondial, et pour que la diplomatie multilatérale et la coopération internationale restent les principaux instruments de la politique mondiale.
À propos de la rédacteur en chef
Achim Wennmann est directeur des partenariats stratégiques du Geneva Graduate Institute, où il est également professeur de pratique dans le programme interdisciplinaire et titulaire de la chaire Nagulendran de médiation pour la paix.
Toutes les publications du Geneva Policy Outlook 2025 sont des contributions personnelles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions des institutions qu'ils représentent, ni celles de la République et État de Genève, de la Ville de Genève, de la Fondation pour Genèveet de l'Institut universitaire de hautes études internationales et du développement.