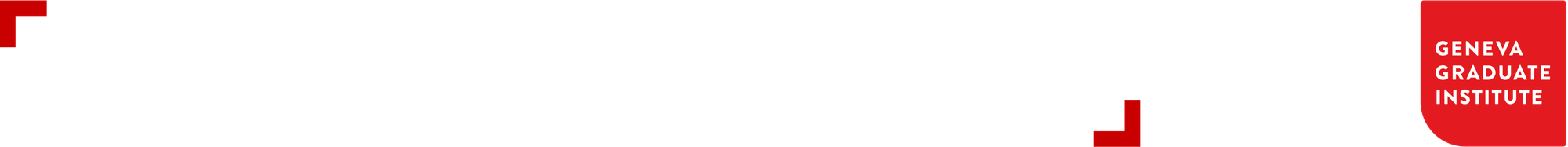Par Irene Ojuok et Alan Channer
Le financement de la lutte contre les émissions de carbone est un vaste sujet. Pour ne citer qu’eux, Microsoft, Netflix, Volkswagen, Shell et AstraZeneca investissent dans le financement de la lutte contre les émissions de carbone pour la restauration et la protection des terres. Des mécanismes visant à réduire la déforestation, les émissions liées à la dégradation des terres ou à piéger le carbone dans la végétation et le sol naissent partout en Afrique. A quel point ces programmes fonctionnent, et au bénéfice de qui, est une question controversée.
Le financement de la lutte contre les émissions de carbone est un instrument pour promouvoir la réduction de CO2 atmosphérique en transférant des fonds des entités émettrices à celles qui multiplient préservent les puits de carbone ou réduisent les émissions. La plupart de ces puits de carbone se trouvent sur les terres, qui sont le moyen de subsistance des petits exploitants agricoles (ceux-ci possédant moins de 2 hectares), qui représentent 80 % des agriculteurs d'Afrique et cultivent environ 40 % des terres agricoles du continent. Environ deux-tiers de ces terres sont dégradées. Lorsque le financement de la lutte contre les émissions de carbone est apparu, il a été encensé, offrant un quadruple avantage : les terres seraient restaurées, le revenu des agriculteurs augmenterait, le carbone serait piégé et les entreprises fournissant les financements pourraient faire la course à l’absence d’émissions.
Au-delà des marges : engager les voix sous-représentées
Cela n’a pas été chose simple. Les exigences des projets qui font le commerce du carbone sur le marché volontaire du carbone sont complexes et strictes. La première exigence essentielle est la permanence : le carbone doit rester piégé pendant au moins 30 ans. La deuxième est l’additionnalité : le carbone piégé dans le cadre d'un projet doit s’additionner à celui qui aurait été piégé sans le projet. La troisième exigence centrale est l’absence de fuites : le piégeage du carbone sur un site ne doit pas entraîner une augmentation des émissions dans un autre. Par exemple, lorsque les arbres sont conservés à un endroit, cela peut engendrer une pression de les abattre ailleurs.
Les agriculteurs doivent accepter toutes les conditions d'un projet carbone dans un contrat portant la mention « consentement libre, préalable et éclairé ». Des difficultés inattendues se sont présentées, y compris, dans certaines circonstances, la perspective de déclenchement de conflits.
La propriété juridique de la terre est un prérequis à la participation aux projets carbone. Toutefois, de nombreuses communautés africaines ne disposent pas de preuves juridiques de la propriété des terres sur lesquelles elles vivent et qu’elles cultivent. En outre, les systèmes coutumiers et héréditaires africains sont communautaires et suppriment la propriété individuelle. Des litiges relatifs à l’utilisation des terres et des arbres peuvent se produire lorsque des titres de propriété et des baux de long terme sont introduits, étant donné que les exigences contractuelles peuvent perturber l’utilisation traditionnelle des terres et l’occupation de l’espace s, et interférer avec les pratiques culturelles. Si les exigences légales ne font pas l’objet d'une introduction et de discussions bienveillantes, elles peuvent donner lieu à des conflits au sein des familles et des communautés. Étant donné que la plupart des petites exploitations agricoles africaines n’ont jamais détenu de terres ancestrales (bien que généralement, ce soient elles qui passent le plus de temps à les cultiver), l’approbation des projets carbone revient invariablement aux chefs de ménages masculins. La perspective de l’accroissement des inégalités de genre n’est pas à négliger. En outre, la question de l’héritage se pose également. Les jeunes ne sont que rarement consultés, même si au cours des 30 années de vie d'un projet, leurs droits d’utilisation de leurs terres ancestrales seront profondément affectés.
Des normes inégales : le biais de sélection des développeurs de projets carbone
Outre ces difficultés, de nombreux développeurs de projets carbone tendent naturellement à sélectionner des propriétaires fonciers détenant des titres de propriété formels. En outre, les coûts de transaction liés à la négociation avec des petits exploitants agricoles multiples peuvent pousser les développeurs à choisir ceux détenant de plus grandes propriétés. Par ailleurs, comme davantage de carbone est piégé dans les sites où la croissance des arbres est meilleure (où les précipitations sont plus importantes et les sols plus fertiles), les développeurs ont tendance à éviter les zones agricoles à faible potentiel, où il serait pourtant nécessaire d’augmenter les investissements pour la restauration. Tous ces facteurs favorisent la sélection d’agriculteurs déjà plus aisés financièrement, et issus de régions agricoles exemptes d’insécurité,déjà productives, exacerbant potentiellement les inégalités et suscitant un mécontentement au sein des communautés marginalisées. Au bout du spectre, les développeurs peuvent racheter les terres des communautés locales ou les expulser des terres consacrées au piégeage du carbone.
Les agriculteurs tendent à être sélectionnés par les projets carbone qui sont plus aisés financièrement, et issus de régions agricoles exemptes d’insécurité,déjà productives, exacerbant potentiellement les inégalités et suscitant un mécontentement au sein des communautés marginalisées.
Les projets carbone peuvent également occasionner des tensions une fois qu’ils ont été lancés. Par exemple, il existe une densité optimale d’arbres sur les terres pour maximiser le piégeage et éviter de réduire les rendements des cultures ou des herbages. La pression foncière pour la sécurité alimentaire ne fera que s’intensifier avec le temps, à l’image de la demande en bois. Il serait avantageux pour l’Afrique de pouvoir produire suffisamment de bois pour subvenir à ses besoins. Les ménages qui consacrent beaucoup de terres et d’arbres au piégeage du carbone peuvent se rendre compte, dix ans plus tard, qu’ils ont compromis d’autres options de subsistance fondées sur les terres, et des conflits sont ainsi susceptibles d’advenir au sein des communautés et entre celles-ci.
Les agriculteurs n’ont souvent pas le savoir-faire technique ni les ressources leur permettant de plaider en faveur de leur cas lors de la mise en œuvre des projets de crédit carbone. La faiblesse de la gouvernance communautaire et des cadres institutionnels en Afrique rurale peut mener à un manque d’équité et de transparence dans les accords de projets. De nombreux projets ont du mal à mettre en place des accords de partage des bénéfices justes et pérennes. Ces difficultés sont exacerbées par l’engagement provisoire des organisations locales de mise en œuvre et les ONG, qui ne restent souvent que cinq ans.
Les programmes de financement de la lutte contre les émissions de carbone peuvent engendrer la transformation en marchandise des écosystèmes naturels et l’empiètement sur les moyens de subsistance ruraux. Un changement considérable en matière d’apprentissage et d’attitude est nécessaire pour faire en sorte que les programmes œuvrent au bénéfice de tous. Il est essentiel de considérer les agriculteurs comme des co-investisseurs et des co-concepteurs de ces programmes, et de prendre en compte les normes sociales et les savoirs autochtones dans la conception du projet dans son ensemble. Le développement d'une telle collaboration nécessite de la transparence, de l’équité et de la confiance. Cela requiert des efforts, mais en fin de compte, cela atténuera les risques liés aux programmes de financement de la lutte contre les émissions de carbone.
L’objectif de Genève : amplifier l’approche sensible vis-à-vis des conflits
On constate des signaux positifs. Certains investisseurs et développeurs de projets exigent désormais en amont des études de faisabilité socio-économiques et socio-culturelles, comprenant notamment l’évaluation des risques de conflits. Le public réalise l’importance d’intégrer des approches sensibles vis-à-vis des conflits dans les programmes carbone pour une restauration holistique et durable des terres par les petits exploitants agricoles.
Genève doit favoriser l’importance d’intégrer des approches sensibles vis-à-vis des conflits dans les programmes carbone pour une restauration holistique et durable des terres par les petits exploitants agricoles.
Juxtaposant la consolidation de la paix, les droits humains, le développement durable, la conservation et les institutions financières, Genève peut jouer un rôle important pour favoriser la durabilité et l’équité des initiatives de financement de la lutte contre les émissions de carbone. Parvenir à restaurer la terre tout en améliorant le niveau de vie des petits exploitants agricoles africains de manière équitable représente également un investissement en faveur de la paix et de la sécurité.
Genève peut contribuer à l’expression des besoins des communautés rurales africaines dans leurs interactions avec des intérêts d’entreprise puissants. Cela peut mettre en avant la programmation sensible vis-à-vis des conflits, l’intégration des questions de genre, les processus de conception de projets participatifs, les mécanismes de partage des bénéfices équitables et l’atténuation des risques liés aux investissements. Cela peut également contribuer à renforcer et à élargir la portée des normes éthiques proposées par le Conseil sur l'intégrité du marché volontaire du carbone.
En promouvant ces recommandations, la communauté genevoise peut améliorer la vie des communautés africaines rurales tout en appuyant les objectifs climatiques mondiaux.
À propos des auteurs
Irene Ojuok est chercheuse doctorale au Right Livelihood College, Centre for Development Research de l'université de Bonn, et professionnelle de la restauration des terres menée par les communautés.
Dr Alan Channer est consultant sur le lien entre consolidation de la paix, restauration environnementale et changement climatique et Maître de recherche à la Global Evergreening Alliance.
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les points de vue du Geneva Policy Outlook ou de ses organisations partenaires.