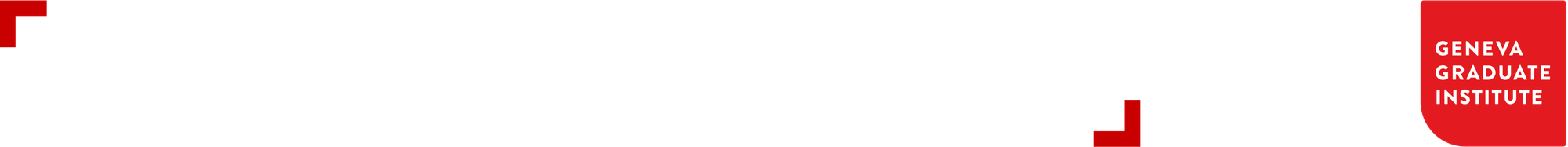Par Marie-Laure Salles
Le 25 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 objectifs. Le Préambule de ce texte était très clair : « ... il ne peut y avoir de développement durable sans paix ni de paix sans développement durable ». Depuis, le développement durable s’est progressivement inscrit au cœur du multilatéralisme, et s’est imposé dans les secteurs aussi bien publics que privés de nombreuses régions du monde. La notion, toutefois, est restée suffisamment vague et imprécise pour laisser une large place à l'interprétation et, par conséquent, à la procrastination, voire à l’évitement.
Une ère d’incertitude radicale
Depuis 2015, nous constatons une intensification et une accélération de nombreux défis auxquels l’humanité est confrontée, et nous avons dû reconnaître notre échec relatif à les résoudre. Nous affrontons des crises interconnectées : le climat, la destruction de la biodiversité, les inégalités extrêmes, la désinformation et les cyberguerres, les pandémies, les guerres, y compris le retour du risque nucléaire, et les menaces technologiques. La dynamique de renforcement entre ces crises donne naissance à l’incertitude radicale qui caractérise notre époque. Ces nombreux défis ont potentiellement un impact existentiel, chacun d’entre eux pris isolément et a fortiori combinés les uns aux autres. Même s’ils ne mettent pas en cause la survie de notre espèce, ils pourraient mener à une redéfinition en profondeur de ce qu’être humain signifie.
En parallèle, nous devons reconnaître que nous ne sommes pas à la hauteur des promesses et des engagements associés à l’Accord de Paris de 2016 et à l’Agenda 2030. Divers rapports montrent qu’il devient de moins en moins probable que nous parvenions à demeurer sous les seuils de +1,5 °C, ou même de +2 °C, fixés par l’Accord de Paris. Nous savons grâce au travail du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qu’une augmentation de 2 °C entraînera des perturbations environnementales d’envergure, aux conséquences indéniablement dramatiques. Dans le même temps, les Nations Unies confirment que nous sommes sur la voie de la réalisation de tout au plus 17 % des objectifs de développement durable que nous nous sommes collectivement fixés en 2015.
Parce que nous sommes aujourd’hui dans une période exceptionnelle, nous devons nous préparer et développer un projet clair, un nouvel agenda pour la durabilité.
Nous pourrions désespérer et renoncer, déclarant la tâche impossible.
Ou nous pourrions affirmer, comme Jean Monnet, « (t)out est possible dans les moments exceptionnels, à condition que l’on soit prêt, que l’on ait un projet clair à l’instant où tout est confus ». Parce que nous sommes aujourd’hui dans une période exceptionnelle, nous devons nous préparer et développer un projet clair, un nouvel agenda pour la durabilité.
Un nouvel agenda pour la durabilité
La durabilité va rester un enjeu majeur pour l’humanité. En principe, nous devrions envisager un chemin de progrès autour de la durabilité avec la volonté d’avancer en tant qu’espèce en parallèle sur toutes les dimensions humaines, environnementales et sociales qui la constituent. Mais il faut se rendre à l’évidence que mettre l’accent sur la durabilité aujourd’hui doit commencer par un objectif plus modeste mais essentiel - celui d’assurer au moins la même qualité de vie aux générations futures. La reconnexion, et plus précisément la reconnexion multidimensionnelle est une manière intéressante de penser la durabilité. Un nouvel agenda pour la durabilité se doit de privilégier à la fois notre reconnexion avec la nature, notre reconnexion les uns aux autres et même une reconnexion avec notre identité humaine. C’est la seule manière dont nous pouvons espérer éviter les perspectives catastrophiques qui se profilent.
Un nouvel agenda pour la durabilité se doit de privilégier à la fois notre reconnexion avec la nature, notre reconnexion les uns aux autres et même une reconnexion avec notre identité humaine.
Notre reconnexion avec la nature implique la préservation de notre biosphère et le respect et la régénération de Humus, notre Terre, la planète à laquelle nous, êtres humains, appartenons et de laquelle dépendent entièrement notre bien-être et notre survie, tout autant que celle des autres espèces. Référence peut être faite ici à l’article d’Hugo Slim sur comment mieux représenter la Terre.
Notre reconnexion avec les autres est tout aussi importante. Elle implique la réinvention d'un contrat social qui, par nécessité, doit avoir une dimension mondiale. En effet, les défis auxquels nous faisons face aujourd’hui ont une échelle et une portée internationales et exigent donc coopération, justice et partage plutôt que compétition, conflits, inégalités et polarisation.
Enfin, il est urgent de nous reconnecter à notre humanité, y compris à notre fragilité, qui est historiquement aussi notre force. Le développement technologique rapide actuel tend à s’accompagner du dépassement voire d’un mépris de l'humain et de ses capacités. Mais qu’est-ce que la technologie si ce n’est une intelligence humaine figée ? Et aujourd’hui, nous avons intensément besoin d’une intelligence humaine et collective vivante, tournée vers le futur – et non figée, reflétant le passé – pour favoriser le type de transformation et d’adaptation systémiques profondes qu’exige l’état de notre monde.
Comment faire avancer cet agenda
L’esprit de Genève – une perspective humaniste courageuse combinée à une logique de collaboration internationale – n’a jamais été aussi pertinent ni aussi nécessaire qu’à l’heure actuelle pour faire avancer ce nouvel agenda pour la durabilité.
Notre nouvel agenda pour la durabilité implique une transition forte – de notre paradigme économique extractiviste actuel vers un nouveau modèle régénératif.
Nous devons changer de paradigme, et agir rapidement. Dans notre système actuel, l’humanité, les espèces vivantes et la nature dans son ensemble sont devenues des ressources et des variables d’ajustement au profit de la croissance économique et financière et du développement technologique. Nous devrions souhaiter exactement le contraire, et nous efforcer d’y parvenir. Dans le cadre d'un nouveau paradigme, nous orienterions et mobiliserions nos capacités immenses au service de la prospérité, du bien-être, de la dignité et de l’émancipation des humains, dans le respect absolu des cycles de régénération environnementaux, que l’article de Channer et Ojuok met en lumière. Notre nouvel agenda pour la durabilité implique une transition forte – de notre paradigme économique extractiviste actuel vers un nouveau modèle régénératif. Cela signifie que nous devons radicalement changer de direction : passer de la croissance à la prospérité, de l’exclusion à l’inclusion, de la concurrence à la collaboration, de l’isolation à la création de liens, du gaspillage au recyclage, de l’avoir à l’être, de la valeur (monétaire) aux valeurs (morales), d’une définition financière à une définition par l’impact positif de la réussite et du succès.
La voie à suivre est claire, et maintenant, nous nous devons d’agir. Cela exige des dirigeants dotés de courage, d'intégrité, de confiance (en eux-mêmes et en un avenir désirable) et d’un sens de la responsabilité pour les défis communs, des individus prêts à collaborer à un effort qui sera nécessairement collectif. Nous devons également identifier et mettre en lien les multiples acteurs et initiatives qui ont déjà mis au point et déployé des solutions qui nous font avancer dans la bonne direction. Il est nécessaire aussi de réinventer des formes de collaboration internationale qui parviennent à concilier l’aspiration de l’humanité à la paix et l’agenda de durabilité d'une manière qui soit juste et équitable, y compris dans une perspective historique. Enfin, et ce n’est pas l’aspect le moins important loin de là, nous devons également réussir à mobiliser le capital financier indispensable à une transformation aussi profonde et importante. Genève a tous les atouts pour se réimaginer en tant que pôle essentiel de cette transition historique : l’héritage, les institutions, l’« esprit », une position agile en tant que pays neutre, des ressources éducatives pertinentes et l’accès aux réseaux financiers. C’est un appel que nous ne pouvons pas manquer !
À propos de l’auteur
Marie-Laure Salles est directrice du Geneva Graduate Institute.
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs. Elles ne prétendent pas refléter les opinions ou les points de vue du Geneva Policy Outlook ou de ses organisations partenaires.